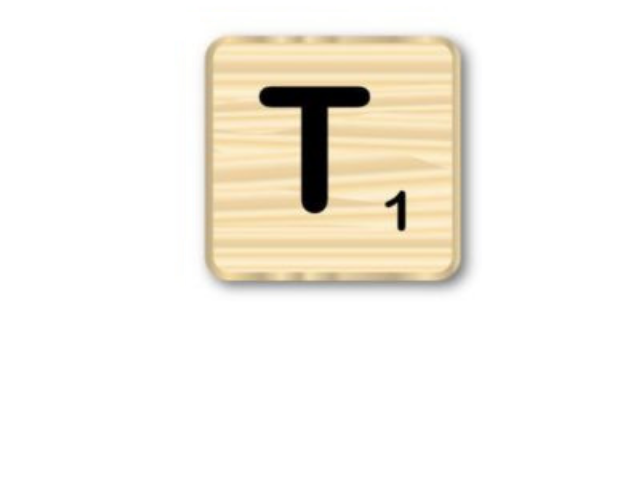
Thuau (Daniel). Né à Loigné en 1928, fils d’Auguste et de Marie Tauvry. Propriétaire exploitant à la Gilardière de Loigné. Il entre au Conseil municipal le 8 mars 1959.
Maire de Loigné de 1963 à 1991. Membre fondateur de l’AS football de Loigné en 1968. Vice-président local de la Mutualité agricole en 1971. Chevalier du Mérite agricole en 1972. Médaille d’argent (1988) et de vermeil (1990) d’honneur régionale, départementale et communale. On lui doit l’adhésion au district urbain de Château-Gontier, le 1er prix des villages fleuris de l’arrondissement de Château-Gontier, la réfection de la toiture du clocher de l’église, l’aménagement du terrain de football du bas, ses douches et son éclairage, la construction d’un bloc sanitaire et WC publics, la construction de l’usine à eau de la Roche avec le concours du syndicat mixte, la construction du Mille-Club, d’un court de tennis et de la zone d’activités, la numérotation des maisons et la dénomination des rues du bourg, les lotissements du Petit-Bocage et du Chemin-Neuf (actuellement rue de l’Ile-de-France). Daniel Thuau est décédé en mars 2013.
(Photo : collection privée).
Tilleul (Le). Cette ancienne fermette doit son nom à l’arbre qui caractérisait la propriété. Le nom tilleul vient du latin populaire tiliolus. Il a remplacé l’ancien français teil (issu du latin populaire tillius) que l’on retrouve dans certains noms de lieux mayennais ou dans le patronyme Dutheil.
En 1900, l’abbé Angot indique dans son Dictionnaire de la Mayenne, l’écart (petite agglomération) du Tilleul. Ce lieu-dit n’apparaît pas sur le plan cadastral de 1833. La maison du Tilleul était habitée en 1901 par Hélène Blin, 83 ans, rentière.
Touches (Les). Ce nom provient de l’ancien français toche (du bas-latin tosca) qui désignait en bouquet d’arbres, un petit bois : « N’espargne bois, buison ne toche » (Gautier de Coincy, Œuvres, vers 1220). Dans le Maine et l’Anjou, la touche désignait plus particulièrement un petit bois clos servant de réserve de chasse. Ici, la réserve de chasse des seigneurs des Monceaux. Les Touches appartenaient en 1785 à Gervais Couppel du Lude, seigneur des Beauvais et des Monceaux (voir ce nom) Mises en vente par la Nation le 21 avril 1807 sur Siméon-Brice Couppel du Lude, elles restèrent dans cette famille qui éleva le logis actuel.
En 1940, le logis servit de quartier général à une division de l’armée allemande et le drapeau nazi flotta sur sa façade d’entrée. M. Antoine Gouabau, propriétaire actuel des Touches, se souvient très bien de cette brève occupation. : J’avais une dizaine d’années à l’époque, il y avait ici toute une compagnie qui resta environnant 8 jours. Les Allemands avaient réquisitionné notre maison et les bâtiments de ferme. Mes parents et mes deux frères, nous logions dans une petite pièce avec des matelas de fortune car ils avaient tout pris. L’officier
occupait la chambre de mes parents à l’étage… Les gradés et l’officier gueuletonnaient là, dans cette grande pièce, tous les soirs en se servant copieusement dans la cave… Il y eut un jour, dans le verger, toute une troupe de soldats que j’estime au moins à 300 hommes… Ils avaient leur roulotte pour la cuisine, un coiffeur et tout ce qu’il faut. Je me souviens d’avoir ramassé avec mes parents, après leur départ, tout un tombereau de boîtes de conserve vide… Devant l’entrée de la maison, il y avait le grand drapeau rouge avec sa croix gammée… Il y avait chez nous, une grande pièce qui servait de bureau. J’entendais le bruit de la machine à écrire toute la journée. Il y avait dans cette pièce un défilé de gradés… Avant de partir, ils brûlèrent un tas de papiers et de cartes d’état-major… ca rougeoyait encore à la nuit tombante.
En 1846, le logis des Touches était habité par Aimée de Préaulx, veuve de Siméon-Brice Couppel du Lude, propriétaire, et ses trois domestiques : Félicité Lemale, 18 ans, Marie Guillet, 19 ans, et Pierre Gondard, 21 ans. La même année, on cite la « maison de maître des Monceaux » qui était habitée par Scholastique et Noémie Couppel du Lude (voir les Monceaux). Cette maison de maître semble correspondre au logis actuel des Touches.
La métairie des Touches était occupée par Pierre-Jean Bodin, laboureur, 36 ans, Joséphine-Eugénie Brault, sa femme, 28 ans, mariés à Bazouges le 20-7-1840, leurs deux filles Estelle Bodin, 5 ans, et Eugénie Bodin, 2 ans, Victor Planchenault, 16 ans, domestique, et Perrine Manceau, 37 ans, domestique.
<
En 1866, le logis des Touches était occupé par la famille Guillet dont Jean-François Guillet, fermier, 45 ans, Huguette-Françoise Bellier, sa femme, 25 ans, mariés à Loigné le 28-4-1862, et leurs trois enfants : Marie, 3 ans, Jean, 2 ans, et Prosper Guillet, 8 jours.
La métairie des Touches était exploitée et habitée par la famille Bodin composée de Pierre Bodin, 55 ans, fermier, Joséphine Broc, sa femme, 43 ans, et leurs trois enfants : Eugénie, 26 ans, Théodore, 16 ans, et Eugène Bodin, 12 ans. Louis Chaignon, 27 ans, était employé comme domestique.
En 1901, le logis des Touches était habité par Jean-Eugène Guillet, 36 ans, garde particulier de M. Couppel du Lude, Séraphine-Marie Perrichet, 32 ans, sa femme, mariés à Loigné le 26-11-1889, et leur fils Alphonse Guillet, 3 ans.
La ferme des Touches était habitée par la famille Aubry composée d’Ambroise-Henri-Joseph Aubry, 60 ans, fermier-patron, Marie-Hortense Maillard, 54 ans, sa femme, mariés à Houssay le 15-2-1872, et leurs quatre enfants : Henri, 28 ans, Marie, 22 ans, Joseph, 18 ans, et Paul Aubry, 14 ans, tous employés agricoles.
Tremblier de la Varanne (Pierre du). Curé de Loigné de 1706 à 1725. Docteur en théologie. Il fut inhumé dans l’église Saint-Maurille d’Angers le 18 août 1725. Il succéda à René allaire et précéda Pierre Parpacé.
Tuilerie (La Grande et la Petite). Alias les Tuileries. Ce nom rappelle une ancienne activité industrielle du pays de Loigné. En ce lieu, anciennement appelé le Chêne-Rond, se développa une fabrique de tuiles et de briques. Cette industrie, déjà en activité en 1668, fut
supprimée entre 1846 et 1866. Autour de cette fabrique s’éleva un hameau et une maison de maître (la Grande-Tuilerie) qui appartenait en 1770 à Auguste-René Gohier.
Pour fabriquer des tuiles et des briques, il fallait obligatoirement avoir :
- de la terre (argile et grès sablonneux) d’où la présence de carrières (les Fosses). Des vestiges de ces carrières sont toujours visibles face à la Grande-Tuilerie, en bordure d’un chemin menant au bois des Rouillères.
- de beaucoup d’eau. L’abbé Angot signale, en 1900, l’étang desséché de la Tuilerie.
- un lieu de séchage qui devait se trouver dans les champs de Beau-Soleil.
- des fours pour la cuisson. Ces fours, alimentés par du bois et du charbon de bois, furent à l’origine d’un grand défrichement d’où les noms de lieux les Landes et la lande de la Fosse.
En 1846, la tuilerie était dirigée par François Moreul, 29 ans, fabricant de tuiles, époux de sa cousine, Louise-Perrine Moreul, 33 ans, mariés à Houssay le 18-11-1839. Il employait et hébergeait 7 journaliers et 3 domestiques, faisant vivre 27 personnes.
En 1866, les Tuileries formaient un hameau regroupant 19 personnes réparties en 6 foyers composés de :
- Simon Régnier, fermier, 52 ans.
- Maurice-Henri Manceau, journalier, 34 ans, Lucie-Marie Guérin, sa femme, 29 ans, mariés à Azé le 3-5-1859, leurs trois enfants, Maurice, 7 ans, Lucie, 4 ans, Jean Manceau, 7 mois.
- François Moreul, propriétaire, 48 ans, Louise Moreul, sa femme, 50 ans, Marie Mulot, domestique, 19 ans.
- Julien-René Mulot, journalier, 52 ans, Marie Houdin, sa femme, 42 ans, mariés à Loigné le 1-2-1846.
- Ambroise-Pierre Serru, cultivateur, 47 ans, Anne Gigon, sa femme, 36 ans, mariés à Houssay le 21-1-1855, Ambroise Serru, leur fils, 7 ans, Marie Serru, leur fille, 3 ans, Joseph Moreau, domestique, 21 ans.
- Pierre Mulot, journalier, 56 ans, Jeanne Jousseau, sa femme, 46 ans, mariés à la Chapelle-Rainsouin le 11-12-1848, Jules Mulot, leur fils, 12 ans.
En 1901, la Tuilerie était habitée par la famille Paillard composée d’Alphonse Paillard, 65 ans, rentier, Louis-François Paillard, 55 ans, ouvrier agricole chez M. Bruand, Marie Gendry, 55 ans, sa femme, mariés à Cossé-le-Vivien le 12-6-1871, Louis-Alphonse Mareau, 30 ans, domestique de ferme chez M. Planchard, Marie-Aurélie Paillard, 28 ans, sa femme, mariés à Loigné le 9-3-1897, et leurs trois enfants, Louis, 4 ans, Marie, 3 ans, et Joseph Mareau, 1 an.
Turmalière (La). Cette ferme disparue de nos jours mais qui existait encore en 1833 sous le nom de Turmaillère était située face au Bas-Ronceray, sur le chemin menant à Chantemesle.
Elle doit son nom à un certain Turmeau, nom de famille, assez répandu dans la partie nord de la Mayenne, qui vient de l’ancien français turme, « troupeau » (surnom d’un gardien ?).
Turpinière (La). Cette ferme doit son nom à un certain Turpin, nom issu de l’ancien français turpin, mot qui désignait une sorte de soldat, et issu d’un mot latin, turpis, signifiant « repoussant », « dépravé ».
En 1247, on signale un chevalier du Craonnais, Guillaume Turpin, qui « était en procès avec la veuve de Jean Le Bigot, et s’appuyait de l’autorité de Geoffroy Payen, sergent ou bailli royal, pour ne pas payer ses dettes ». Un exemple type d’homme « repoussant » qui ne peut renier l’origine de son nom.
Le nom de famille Turpin se retrouve régulièrement dans les registres paroissiaux et d’état-civil de Loigné, du 17e au 19e siècle. À la fin du 17e siècle, on signale le mariage à Loigné le 1-6-1686 de Julien Turpin, né vers 1656, veuf de Perrine Ciron, avec Marie Guais, et, le 24-1-1690, celui de Perrine Turpin, née vers 1665, fille de Julien Turpin et de Françoise Pineau, avec René Guidault.
90, celui de Perrine Turpin, née vers 1665, fille de Julien Turpin et de Françoise Pineau, avec René Guidault.
Le domaine de la Turpinière appartenait en 1563 à « noble homme » Clément Jamelot.
C’est dans l’étang de la Turpinière, déjà desséché en 1900, que se noya accidentellement, en 1665, un prêtre nommé Jean Lelardeux.
En 1866, la Turpinière était occupée par Alexandre-Eugène Madiot, 37 ans, fermier, Sophie-Marie Granger, sa femme, 27 ans, mariés à Loigné le 6-10-1861, leurs deux filles Marie, 3 ans, et Armandine, 1 an, Pierre Persigan, 45 ans, domestique, Pierre Monnier, 30 ans, domestique, Marie Desestres, 29 ans, sa femme, Barthélemy Vasseur, 20 ans, domestique, et Adolphe Régereau, 14 ans, domestique.
En 1901, on y trouve la famille Houssin avec Jacques Houssin, 59 ans, fermier-patron, Jeanne Grélard, 60 ans, sa femme, Ernest Houssin, 32 ans, leur fils, employé agricole, et Valentine Houssin, 21 ans, leur fille, employée agricole.