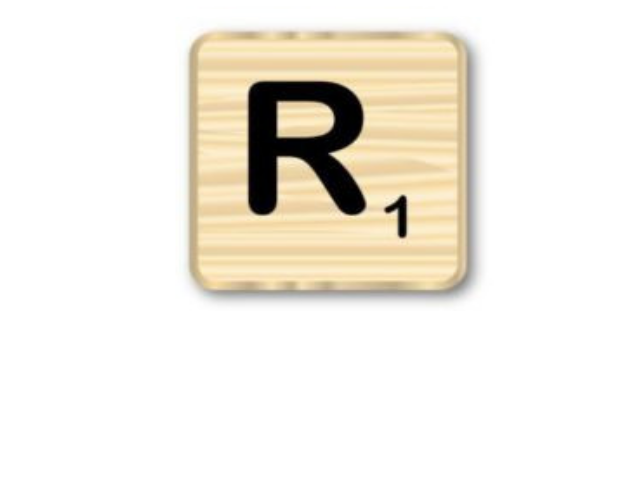
Raffray (François). Né vers 1732. Closier et laboureur à la Chevalerie. Le 26 décembre 1794, il fut pris en otage par des Chouans, massacré à coups de sabre et jeté dans l’étang des Monceaux. Voir la Chevalerie.
Raimond (Paul, Ignace, Gustave). Né le 1er -2-1921 à Bais. Ordonné prêtre le 11-2-1945, il fut tour à tour vicaire auxiliaire à Juvigné de 1945 à 1946, vicaire à Châtillon-sur-Colmont de 1946 à 1948, à Renazé de 1948 à 1951, curé de Loigné de 1951 à 1955, puis curé de Congrier de janvier à avril 1955. Il décéda le 19-4-1955 et fut inhumé à Hambers. Il reçut à Loigné, le 10-6-1953, Mgr Rousseau, évêque de Laval.
(Photo : ADM 1516 W 835, année 1940).
Rambert (Charles). Né à Elbeuf (Seine-Maritime), domicilié à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), artiste dramatique et soldat franc-tireur de la Creuse pendant la guerre de 1870 et 1871. Il mourut noyé le 10 février 1871 en traversant la Mayenne auprès des ruines du pont de la Valette qui avait été dynamité pour stopper l’invasion prussienne. Son cadavre fut trouvé sur la commune de Loigné le 12 mars suivant et enterré le même jour dans le cimetière de Loigné. Voici ci-après une partie de la transcription du jugement, en date du 20 juillet 1871, concernant son décès qui fut inscrit dans le registre d’état-civil de la commune de Loigné : « L’an mil huit cent soixante-onze, le vingt juillet à neuf heures du matin, nous Léon Laumaillé, maire et officier de l’état civil de la commune de Loigné, canton et arrondissement de Château-Gontier, département de la Mayenne, nous avons transcrit sur les registres de notre état civil le jugement qui suit.
République Française. Au nom du peuple Français, le Tribunal civil de première instance séant à Château-Gontier, département de la Mayenne, a rendu le jugement suivant :
Ouï le rapport fait à l’audience publique de ce jour par Monsieur Véron, juge commis d’une requête présentée par Monsieur le Procureur de la République près ce siège, de laquelle requête la teneur suit : A Monsieur le Président du Tribunal civil de première instance séant à Château-Gontier, département de la Mayenne ; le Procureur de la République près le même Tribunal a l’honneur… de vous exposer que le douze mars dernier, le cadavre d’un inconnu a été retiré de la Mayenne sur le territoire de la commune de Loigné que les renseignements donnés alors firent présumer que cet individu pouvait être un franc-tireur de la Creuse qui avait trouvé la mort le dix février précédent, vers quatre heures du soir, en passant la rivière la Mayenne auprès des ruines du pont de la Valette, pour aller de la rive droite, commune d’Origné, sur la rive gauche, commune de Villiers-Charlemagne, en compagnie du sieur Toqué, de la femme de ce dernier, et du sieur Joseph Dubreuil, franc-tireur de la Creuse.
Qu’il résulte en effet d’un procès verbal dressé par Monsieur le Commissaire de Police de la ville de Guéret, agissant comme auxiliaire de Monsieur le Procureur de la République, en la même ville, le six avril dernier que le franc-tireur dont le cadavre a été trouvé le douze mars dernier, en la commune de Loigné, est bien le nommé Charles Rambert, artiste dramatique, franc-tireur de la Creuse, domicilié à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), né le quinze octobre mil huit cent quarante trois à Elbeuf (Seine-Inférieure), fils naturel d’Emilie-Eléonore-Marie
Rambert, et qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner l’inscription sur les Registres de la commune de Loigné du jugement à intervenir pour servir d’acte de décès… ».
Registres d’état-civil. Ils ont remplacé, selon un décret du 20 septembre 1792, les registres paroissiaux (voir ci-après). Ils furent confiés à des agents municipaux (maires ou leurs représentants légaux). A partir du 9 mai 1800, les registres étaient pré-imprimés pour faciliter la compréhension et la tenue des nouveaux registres. Une difficulté se présente aux généalogistes amateurs quant aux dates des actes car le calendrier grégorien (le nôtre actuellement) fut remplacé par le calendrier républicain. L’An II de la République commençait au 22 septembre 1793 pour se terminer au 5e jour complémentaire de fructidor, soit le 21 septembre 1794. Cette méthode perdura jusqu’au 1er nivôse de l’An XIV (22 décembre 1805). Chaque année se décomposait en 12 périodes plus 5 jours complémentaires voir 6 jours complémentaires (An IV ou 1796, An VII ou 1799, An XI ou 1803). Les noms traditionnels des mois furent remplacés par des noms républicains : vendémiaire (22 septembre au 5, 6, ou 7 octobre suivant les années), brumaire (22, 23 ou 24 octobre au 20, 21 ou 22 novembre), frimaire ( du 21, 22 ou 23 novembre au 20, 21 ou 22 décembre), nivôse (du 21, 22 ou 23 décembre au 19, 20 ou 21 janvier), pluviôse (du 20, 21 ou 22 janvier au 18, 19 ou 20 février), ventôse (du 19, 20 ou 21 février au 20, 21 mars), germinal (du 21 ou 22 mars au 19 ou 20 avril), floréal (du 20 au 21 avril au 19 ou 20 mai), prairial (du 20 ou 21 mai au 18 ou 19 juin), messidor (du 19 ou 20 juin au 18 ou 19 juillet), thermidor (du 19 ou 20 juillet au 17 ou 18 août), fructidor (du 18 ou 19 août au 21 au 22 septembre).
Pour ceux qui sont en quête de leurs ancêtres, sachez que ces registres d’état-civil ont été mis en ligne sur le site des Archives de la Mayenne. Voici, ci après la liste des registres d’état-civil de Loigné consultable sir ce site internet. Les lettres N, M, D correspondent à naissance, mariage, décès : NMD 1793 ; NMD 1793-an V, NMD an VI-an X, NMD an XI-1807 ; NMD 1808-1812 ; NMD 1813-1817 ; NMD 1818-1822 ; NMD 1823-1827 ; NMD 1828-1832 ; NMD 1833 ; NMD 1834-1837 ; NMD 1838-1842 ; NMD 1843-1847 ; NMD 1848-1852 ; NMD 1853-1857 ; NMD 1858-1862 ; NMD 1863-1867 ; NMD 1868-1872 ; NMD 1873-1877 ; NMD 1878-1882 ; NMD 1883-1888 ; Jugements rectificatifs 1883-1892 ; Reconnaissances 1883-1892 ; NMD 1889-1894 ; Divorces 1893-1902 ; Jugements rectificatifs 1893-1902 ; Reconnaissances 1893-1902 ; NMD 1895-1900 ; Table des décès 1893-1902 ; Table des mariages 1893-1902 ; Table des naissances 1893-1902.
Pour les autres registres NMD, de 1901 à nos jours, voir directement à la mairie de Loigné. Depuis les années 1950, les naissances se font pratiquement toujours à la maternité de Château-Gontier et ne sont que retranscrit sur les registres de la mairie de Loigné. Quant aux sépultures, elles sont très souvent inscrites sur des registres d’autres communes suivant les lieux de décès (hôpitaux, maisons de retraite, accidents de la circulation…) et sont parfois retranscrit sur les registres de Loigné.
Registres paroissiaux. L’ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée par le gouvernement de François 1er, obligeait les prêtres à tenir des registres paroissiaux en français (et non en latin) dans lesquels ils devaient noter les baptêmes, et les sépultures de leurs paroissiens. Plusieurs autres ordonnances (1579, 1667 et 1736) prescrivaient de tenir en double ces registres ; l’original restant à la paroisse, la copie allant au greffe de la juridiction royale la plus proche. L’inscription des mariages fut rendue obligatoire par l’ordonnance de Blois en mai 1579. Ces registres furent tenus par les curés jusqu’à la Révolution, époque à laquelle ils furent remplacés par les registres d’état-civil tenus par le maire ou son adjoint.
Pour la paroisse de Loigné, malheureusement, certains de ces registres ont disparu (détruits ou perdus). Les plus anciens registres parvenus à ce jour remontent à 1616. Avant cette date et de 1642 à 1661, on en a plus de traces.
Ces registres ont été mis en ligne sur le site internet des Archives de la Mayenne. Voici, ci-après, la liste des registres que l’on peut consultés. B représente les baptêmes, S les sépultures, M les mariages : BMS 1616-1641 ; S 1662-1676 ; BMS 1668-1705 ; BMS 1706-1716 ; BMS 1717-1723 ; BMS 1725-1740 ; BMS 1741-1751 ; BMS 1752-1762 ; BMS 1763-1764 ; BMS 1765-1779 ; BMS 1780-1792.
(Photo : un acte de baptême de 1618).
Rezé (Famille). Vieille famille de paysans et d’artisans connue à Loigné depuis le 17e siècle. Parmi les mariages Rezé à Loigné, nous avons relevé ceux de :
- Jean Rezé, vers 1658, fils de Julien et de Jeanne Eschard, marié à Loigné le 20-6-1682 avec Perrine Béguin.
- Jean Rezé, né vers 1642 à Quelaines, marié le 14-7-1663 à Quelaines avec Renée Saulou, remarié à Loigné le 2-7-1682 avec Michelle Legendre.
- Jean Rezé, né vers 1672, fils de Jean et de Françoise Leseyeux, marié à Loigné le 14-7-1696 avec Anne Richard.
- René Rezé, né vers 1693, fils de René et de Jeanne Bonhommet, marié à Loigné le 19-5-1718 avec Julienne Clément.
- Jean Rezé, né vers 1691, fils de Jacques et de Jeanne Letessier, marié à Loigné le 6-11-1719 avec Jeanne Turpin, remarié à Loigné le 29-5-1725 avec Perrine Bertron, née vers 1701, fille de René et de Perrine Rolland.
- Jean Rezé, fils de Jean et de Madeleine Bouleau, marié à Loigné le 30-1-1757 avec Françoise Corbin.
- Jean Rezé, né vers 1735, fils de Jean et de Françoise Lemesle, marié à Loigné le 19-5-1767 avec Anne Cosson.
- René Rezé, né à Villiers-Charlemagne le 25-10-1785, charpentier à Ruillé puis à Loigné, marié à Loigné le 19-5-1813 avec Renée Bodinier.
- François Rezé, né à Loigné le 25-6-1815, charpentier à Loigné, fils de René et de Renée Bodinier, marié à Loigné le 2-8-1851 avec Anne Gerbouin.
- Victor Rezé, né à Loigné le 27-7-1825, charpentier à Loigné, fils de René et de Renée Bodinier, marié à Loigné le 26-2-1854 avec Scolastique Hamon.
- Louis Rezé, né à Loigné le 30-4-1814, charpentier à Loigné, fils de René et de Renée Bodinier, marié à Loigné le 29-4-1855 avec Anne Pineau.
- Auguste Rezé, né à Loigné le 2-8-1822, domestique agriculteur à Houssay, fils de René et de Renée Bodinier, marié à Loigné le 8-11-1857 avec Emilie Gigon.
- Jean-Pierre Rezé, né à Houssay le 2-8-1825, domestique cultivateur à Loigné, fils de Jean et de Marie Bouvier, marié à Loigné le 13-6-1858 avec Sophie Lancelot.
- Victor-François Rezé, né à Loigné le 27-7-1854, charpentier à Loigné, fils de Victor et de Scolastique Hamon, marié à Loigné le 2-7-1881 avec Ernestine-Louise Véron.
- Prosper-François Rezé, né à Loigné le 5-8-1862, charpentier à Loigné, fils de Victor et de Scolastique Hamon, marié à Loigné le 22-11-1887 avec Marie-Augustine Petit.
- François Rezé, né à Houssay le 15-7-1844, domicilié à Quelaines, veuf de Marie-Jeanne Haileau, fils de François et de Julie-Françoise Courrier, marié à Loigné le 14-9-1896 avec Joséphine-Céleste Losier.
Richard (Le). Du nom d’homme Richard, nom de baptême devenu nom de famille, issu du germanique (franc) Ric- (puissant) et hard (dur, fort). D’après l’abbé Angot, « les noms d’homme sans suffixe et sans article ont servi de nom local dans une centaine de cas seulement » en Mayenne : Renaud (Laigné), Aubert (Chailland), Besnier (Oisseau)…
Le patronyme Richard est connu à Loigné dès le 17e siècle : Anne Richard, née vers 1673, fille de François Richard et de Michelle Deslandes, épousa Jean Rezé à Loigné le 14-7-1696. On retrouve des mariages Richard à Loigné également en 1734, 1740, 1766, 1780, 1805, 1813, 1856, 1858, 1861, 1881… Une famille Richard possédait le domaine de Chantemesle (voir ce nom) au 18e siècle.
C’est probablement cette ferme qui, avec celles de Vaufaron et de la Roche (voir ces noms), revint en héritage à François Bionneau en 1789 sous le nom de Richardière.
En 1866, le Richard était occupé par Etienne-François Ciron, propriétaire-cultivateur, 38 ans, Françoise Boulay, sa femme, 38 ans, mariés à Coudray le 17-4-1849, François Ciron, leur fils, 12 ans, Marie Ciron, leur fille, 8 ans, Charles Fouchard, domestique, 45 ans, et Amélie Couet, domestique, 16 ans.
En 1901, on y trouve Marie-Louise Guais, 52 ans, fermière-patronne, veuve d’Etienne-François Ciron, mariés à Loigné le 27-7-1873, et Pierre Ciron, son fils, 17 ans, employé agricole.
Robin (Michel). Vicaire de Loigné. Il fut commis pour desservir la cure en 1467 en remplacement de Gilles Vallié, curé de Loigné en 1460. Une famille Robin vivait encore à Loigné au début du 18e siècle. Le 20 mai 1704, on signale le mariage à Loigné de Françoise Robin, fille d’Isaac Robin et de Marie Fain, avec Pierre Croissant.
Roche (La). Aussi appelé Roche de Maine ou Roche du Maine, ce lieu doit son nom à l’escarpement rocheux de la rive gauche de la Mayenne, rivière connue anciennement sous le nom de Maine ou Mayne.
Les moulins et l’écluse de la Roche sont cités dès 1225, date à laquelle le seigneur de Baubigné (Fromentières) se disait propriétaire de l’écluse de Rocha.
En 1456, on cite la métairie et le moulin de la Roche de Mayenne qui appartenait à Guillaume de Denée, écuyer.
En 1634, Charles Foucault et Charles de Villeprouvée se titraient de sieurs de la Roche.
En 1660, le moulin de la Roche faisait parti des biens de Lancelot de Quatrebarbes (voir Aviré, Fontenelle, Viaulnay).
La métairie de la Roche fut vendue en 1730 par Louis-Philippe des Haies, seigneur de Cosmes, aux enfants de Charles Millet, notaire à Château-Gontier.
En 1789, Alexandre Bionneau léguait à son fils François Bionneau, ancien gendarme du Roi, les fermes de Vaufaron, de la Richardière (voir le Richard) et de la Roche.
Un poste de gabelle y était établi avant la Révolution. Emery de la Court, archer originaire de Caen, y fut tué en 1628.
En 1900, le hameau de la Roche regroupait 16 personnes.
A ce lieu se rattache une légende, celle du Pas du Diable ou Pas du Boeuf. Dans une prairie, au bord de l’eau, peu après le moulin, le long d’un bois à flanc de coteau, se trouve une pierre de grès sur laquelle certains yeux avisés voient l’empreinte d’un pied gigantesque qui juste en face, de l’autre côté de la rivière, se répète exactement. Pour certains, c’est le Diable qui, se rendant à un sabbat (peut-être à Helquin, voir ce nom), fit ces empreintes en sautant d’un bond la rivière fort large à cet endroit. Pour d’autres, ce serait Gargantua l’auteur de ces empreintes. Ce géant affamé aurait enjambé la Mayenne à la poursuite d’un bœuf d’où l’autre appellation de Pas du Bœuf.
A propos du barrage de la Roche, voici ce que signale l’Inventaire général du patrimoine culturel : « Une chaussée existe à la Roche-de-Maine depuis au moins le 14e siècle. Elle assurait le fonctionnement de deux moulins, situés sur chacune des deux rives. Dotée d’une porte marinière après 1537, elle a été remplacée par un barrage à écluse lors de la canalisation de la Mayenne. Les travaux ont été suivis par l’ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées Legras sur les plans étudiés en grande partie par son prédécesseur Lahougue et approuvés par le ministre en 1865. Ils ont été menés par les entrepreneurs de Brest Buré et Crosnier, choisis lors de l’adjudication du 12 septembre 1874. Ils sont presque terminés en 1876 lors du passage des premiers bateaux par l’écluse. Mais du fait des dégâts causés par les crues de 1878, 1879 et 1880, ils ne sont définitivement reçus que le 14 mars 1882. La réalisation du nouveau barrage n’a pas nécessité la démolition des moulins, déjà reconstruits en 1842 pour celui de la rive droite et en 1850 pour celui de la rive gauche ».
En 1866, la ferme de la Roche était exploitée par François Piray, fermier, 67 ans, veuf de Jeanne Véron, mariés à Saint-Gault le 11-10-1829, ses trois fils, François, 34 ans, Henri, 30 ans, et Eugène Piray, 24 ans, sa fille Françoise Piray, 29 ans, et Marie Desnoë, 18 ans, domestique.
Le moulin de la Roche était occupé par Jean Fouché, 64 ans, meunier, veuf, qui employait et hébergeait six domestiques : Renée Dupin, 30 ans, Clémentine Gohier, 43 ans, Auguste Juliot, 46 ans, Pierre Hallais, 29 ans, François Bodard, 42 ans, Jules Drulin, 36 ans. Emile Gohier, fils probable de Clémentine, âgé de 4 ans, vivait avec eux en tant que pensionnaire.
En 1901, la ferme de la Roche était exploitée par la famille Piray composée d’Hortense Piray, 55 ans, fermière-patronne, épouse de Henri-Victor Piray, mariés à Quelaines le 11-5-1869, et ses deux fils, Joseph, 19 ans, et Alphonse Piray, 14 ans, employés agricoles.
L’écluse de la Roche était occupée par Camille-Marie Frippier, 39 ans, éclusier, Marie Renou, 37 ans, sa femme, mariés à Château-Gontier le 7-11-1885, Camille Frippier, leur fils, 13 ans, et Eugène Chevalier, 1 an, nourrisson.
Le moulin de la Roche était tenu par Emmanuel Georges, minotier-patron qui employait et hébergeait Adolphe Lancelin, 57 ans, roulier, Louis Jacquelin, 38 ans, roulier, Henri Beaugendre, 44 ans, ouvrier meunier, Auguste Véron, 20 ans, ouvrier meunier, et Rosalie Mulot, 50 ans, cuisinière.
Ronceray (Le). Ce nom vient de l’ancien français ronceroi/roncerai qui désignait un terrain couvert de ronces (du bas-latin rumicem).
L’abbé Angot signale, en 1900, le Haut et le Bas Ronceray qui se composaient d’un hameau et d’une ferme. Le hameau occupait l’emplacement de l’actuel Ronceray et la ferme se trouvait sur le chemin de Chantemesle. Elle était occupée en 1749 par la famille Gevrèze ou Gevraise.
Le Bas Ronceray fut vendu, en 1660, par François Lemasle, avocat à Château-Gontier, et par son frère, prêtre, à Gatien de Galliczon ou Gallisson qui fut nommé président au Présidial de Château-Gontier en 1642 et conseiller du roi. De son mariage avec Michelle Berthereau, il eut trois filles et un fils : Marie, religieuse aux Ursulines de Château-Gontier (1638), Michelle, épouse de René Pitard, procureur du roi à Château-Gontier, Marguerite, épouse d’Abel Avril, conseiller au Présidial d’Angers, et Gatien, également au Présidial de Château-Gontier, seigneur du Plessis-Galleron (Chazé, 49) et du Jarry (Saint-Sulpice). Ce dernier, nommé conseiller d’Etat et maître des requêtes de la Reine-mère (1657), avait pour armoiries : « d’azur (bleu) au lion d’or (jaune) ». Il fut inhumé dans l’église de Saint-Michel-de-la-Roë en 1695. Il avait épousé Marie-Madeleine Le Loyer dont il eut un fils également prénommé Gatien, né à Angers en 1658, qui devint docteur en droit à Angers, docteur de Sorbonne et évêque d’Agathocle. Celui-ci mourut missionnaire en Perse à Ispahan le 22 septembre 1712.
A la suite de la famille Galliczon se succédèrent en tant que sieurs du Ronceray : François Bernard, écuyer, époux de Françoise Poisson, veuve en 1724, et Jean-Julien-Guy Renard, 1749, 1763.
En 1794, le Bas Ronceray était occupé par Mathurin Chevalier, 62 ans, journalier, et Jean Béton (voir Fouassier François), journalier, 59 ans.
En 1866, le village du Haut-Ronceray regroupait 14 personnes réparties en 4 foyers : Jean Bodin, journalier, 54 ans, Anne Lemonnier, sa femme, 43 ans, mariés à Loigné le 1-10-1843, Célestine Bodin, leur fille, 9 ans, Toussaint Jamin, journalier, 40 ans, Marie Damourette, sa femme, 30 ans, Marie, 11 ans, Alphonse, 10 ans, Victor, 7 ans, Esther, 5 ans, Adèle, 3 ans, et Joseph, 7 mois, leurs enfants, Jean Desnault, cantonnier, 59 ans, Anne Pellier, sa femme, 58 ans, et la veuve Gautier, journalière, 50 ans.
Le Bas Ronceray était occupé par Louis Besnier, fermier, 60 ans, Marie Masse, sa femme, 47 ans, Louis, 17 ans, Marie, 15 ans, et Arsène Besnier, 13 ans, leurs enfants.
En 1901, la ferme du Ronceray était tenue par la famille Régnier composée de Louis Régnier, 52 ans, fermier-patron, Marie Planchard, 43 ans, sa femme, Louis Régnier, 16 ans, leur fils, employé agricole, et Marie Régnier, 14 ans, employée agricole.
Rouillère (Auguste). Né le 28 avril 1884 au bourg de Loigné, fils d’Auguste Rouillère, tonnelier, et d’Esther Jammin. Marié à Chalonnes-sur-Loire le 17 janvier 1910 avec Berthe Desnos. Soldat de 2e classe au 54e régiment d’Infanterie. Mort pour la France à l’âge de 32 ans. Tué à l’ennemi le 21 juin 1916 à Damloup (Meuse).
Rouillère (La). Ce nom de lieu pourrait être une déformation de Raoulière si on se réfère aux textes anciens concernant d’autres Rouillère du département : la Rouillère de Ballots citée en 1457 sous le nom de Raoulière ; la Rouillère de Laval citée en 1241 sous le nom de Raoulière. Dans ce cas, ce nom désignerait à l’origine le domaine agricole d’un certain Raoul, nom de baptême, devenu nom de famille, d’origine germanique (franque) composé de deux mots : Rad- (conseil) et wulf (loup).
Une autre explication de ce nom est possible. Il pourrait provenir de l’ancien français roeillier ou roeler, verbe issu de roele (roue, rond). Au 12e siècle, un roeleis ou roleis désignait un retranchement de forme circulaire formé de troncs d’arbres et de branchages serrés. Ce genre de construction est typique des mottes féodales (généralement rondes) qui furent édifiées aux 10e-11e siècles. « la motte féodale constituait l’élément central des premiers châteaux. Cette butte artificielle entourée d’un fossé supportait une tour en bois. L’ensemble était complété par une basse cour défendue par un fossé et une palissade » (Daniel Pichot, La Mayenne des origines à nos jours, 1984).
Pour la Rouillère de Loigné, la seconde explication semblerait la plus vraisemblable puisque les vestiges d’une motte féodale entourée d’anciennes douves y sont encore visibles. On la remarque très bien sur le plan cadastral de 1833 (voir photo ci-dessous).
Cet ancien domaine féodal s’étendait sur les paroisses de Loigné, Peuton et Marigné-Peuton. Il était en parie occupé par un vaste espace forestier dont il ne reste plus aujourd’hui que le bois des Rouillères. Ce bois s’étendait jadis jusqu’au niveau des Landes, à l’est, et arrivait à proximité du bourg, à l’ouest. Cet espace forestier était encore au 18e siècle parsemé d’étangs et de marécages (voir la Marchais).
En 1414, on cite la terre seigneuriale des Rouillères avec « appartenances, tant fiez (fief), domaine que voairie (voirie), justice et seigneurie ».
Parmi les seigneurs de la Rouillère ou des Rouillères, nous citerons :
- Guillaume Morin, sieur de Loudon et de la Porte (Daon), époux de Marie Frézeau, 1390, 1414.
- Guillaume du Guesclin, époux de Florie Morin, 1402, 1409, 1414.
- Charles de Rohan, 1417, époux de Catherine du Guesclin, veuve en 1450. a la mort de ce dernier, le domaine revint à ses enfants sous la tutelle de Georges de la Trémoille, époux de Marie de Montauban, 1465.
- Pierre de Rohan, duc de Nemours, 1508.
- Jeanne de Saint-Séverin, veuve de Charles de Rohan, 1528.
- François de Rohan, 1558.
- Eléonore de Rohan, épouse de Louis de Rohan, 1566,1579.
- Louis de Rohan, 1623.
- Charles de Rohan, 1665.
Au début du 18e siècle, la ferme de la Rouillère fut acquise par le fermier Gervais Jousse. Par partage avec Pierre Syette, gendarme de la garde royale, N. Maumousseau ou Maumusseau devint propriétaire du domaine. Ce dernier avait épousé Renée Jousse. Pierre Syette avait épousé Marie Dublineau, fille de Pierre Dublineau et de Françoise Maumousseau, à Bazouges le 22-10-1704.
Par héritage, la terre revint à son fils Pierre-René Syette, 1777, 1782. Il était le fils de Pierre Syette. Il avait épousé Jeanne Jousse, fille René Jousse et de Marie Foureau, le 27-1-1742 en la paroisse Saint-Rémi de Château-Gontier. La famille Syette possédait &eac