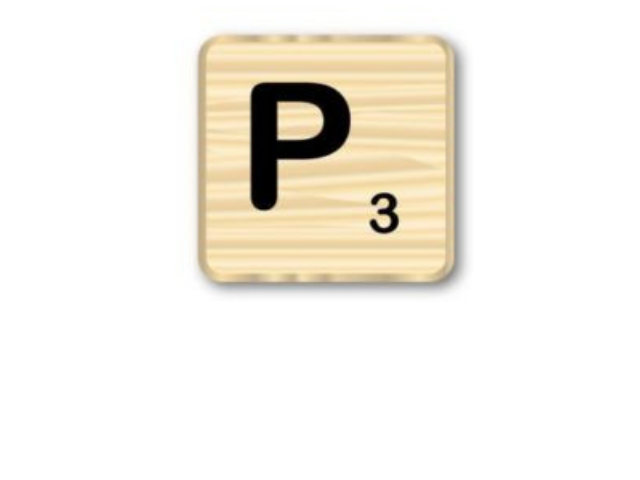
Paillard (Augustin). Né le 9 mai 1876 à Bazouges, domicilié à Loigné à sa mobilisation. Soldat au 25e Régiment d’Infanterie Territoriale. Mort pour la France à l’âge de 38 ans, décédé des suites de blessures à Berles-au-Bois (Pas-de-Calais) le 10 octobre 1914.
Paroisse. La paroisse relevait autrefois du diocèse d’Angers, de l’archidiaconé d’Outre-Maine et du doyenné de Craon. Après 1577, elle dépendait de l’élection, du ressort judiciaire, et du grenier à sel de Château-Gontier, de la province ecclésiastique de Tours. En 1790, elle fut rattachée au district de Château-Gontier et au canton de Laigné. En 1801, elle fut annexée au diocèse du Mans puis, par décret du 5 nivôse an XIII (26 décembre 1804) elle fut érigée en succursale de l’archiprêtré et du doyenné de Château-Gontier. En 1855 elle fut rattachée au diocèse de Laval qui venait d’être formé à partir du démantèlement de ceux d’Angers et du Mans.
Depuis 1997, elle a rejoint la paroisse Saint-Jean-Bosco du Haut-Anjou qui englobe les paroisses d’Ampoigné, Chemazé, Houssay, Laigné, Loigné-sur-Mayenne, Marigné-Peuton, Peuton, Quelaines-Saint-Gault, Saint-Sulpice et Simplé. Depuis 2002, elle dépend de la province ecclésiastique de Rennes.
Pour la liste des curés de Loigné, voir à Eglise Saint-Aubin.
Depuis le 28 septembre 2014, la paroisse Saint-Jean-Bosco du Haut-Anjou est desservie par le père Germain Dih, originaire de Côte d’Ivoire, qui est aidé dans sa tâche par un diacre permanent, Alain Ruault.
Il assure une messe en l’église de Loigné le premier mercredi du mois à 9 h 30, et il tient une permanence tous les samedis, de 14 h à 16 h, en la maison paroissiale Saint-Jean-Bosco située à Quelaines, au n° 8, place de l’Eglise. Voir à Curés et Eglise.
Parpacé (Pierre). Vicaire de Loigné en 1706 puis curé de Loigné de 1725 à 1742. Il succéda à Pierre du Tremblier de la Varanne et précéda René Parpacé, son frère. Il fut inhumé à Loigné le 17 octobre 1742 en présence de René Parpacé, prêtre, son frère, Charles Baraize, prêtre, chanoine de Saint-Léonard de Chemillé (49), Joseph Chéreau, vicaire de Loigné, Sulpice Chapon, vicaire de Peuton.
Parpacé (René). Frère du précédent, curé de Loigné de 1742 à 1748. Il fut inhumé le 25 janvier 1748 dans le cimetière de Loigné à l’âge d’environ 64 ans en présence de Charles Lepage, vicaire de Saint-Jean de Château-Gontier, et Joseph Peltier, vicaire de Loigné. Il précéda Mathurin Chesneau.
Pâtis (Le). Ce lieu-dit résulte du démembrement du village des Morillands (voir ce nom). Il n’est pas cité sur le plan cadastral de Loigné de 1833. Le pâtis, mot issu du latin pastus, « pâture », désignait à l’origine une terre inculte où on faisait paître le bétail. Il semblerait que le Pâtis soit la nouvelle dénomination de l’ancienne Petite-Noë (voir ce nom). Ce nom de ferme n’apparaît pas dans le recensement de 1866, ni dans celui de 1901.
116
Patrimoine. Il existe peu de monuments patrimoniaux sur la commune de Loigné. Parmi ceux encore existants, nous citerons l’église Saint-Aubin (I.M.H.), d’origine romane (11e-12e siècles), agrandie au 15e-16e siècles et remaniée au 18e siècle, deux retables dans l’église, 17e et 18e siècles, dont le retable du maître-autel (M.H.), la mairie, ancien presbytère du début du 19e siècle, la chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Viaulnay, du 16e siècle, dolmen de la Pescherie ou de la Cadeurie, anciens manoirs de la Frézelière, de Viaulnay, Malabry, et de la Françoisière. Châteaux des Touches de des Poiriers (19e siècle). Chaque année, lors des Journées du Patrimoine, les visiteurs peuvent visiter gratuitement l’église Saint-Aubin et la chapelle Notre-Dame-de-Pitié.
Pau (Le). Aussi appelé l’Espeau ou l’Epeau.
Cette ancienne ferme est indiquée sur la carte de Cassini (18e siècle) et le plan cadastral de 1833 sous l’orthographe le Pau, mais Léon Maître, dans son Dictionnaire topographique de la Mayenne, se basant sur des archives de 1660, signale la ferme de l’Espeau.
Deux origines du nom sont donc possibles. Soit ce nom provient de l’ancien français espal/espau qui désignait une réserve seigneuriale dans une forêt, soit il provient du latin palus, « pieu » et désigner ainsi l’endroit où l’on exécutait les condamnés. Au Pault de Nuillé-sur-Vicoin, aussi appelé l’Epau, s’élevaient les fourches patibulaires. Signalons que le seigneur des Monceaux, domaine seigneurial dont dépendait le Pau, avait droit de haute-justice c'est-à-dire qu’il avait le droit de vie et de mort sur ses sujets.
La closerie du Pau fut vendue par la Nation le 14 février 1798 au détriment de Pierre-François-Rosalie Syette de Villette. Ce dernier, garde du roi en 1786, rejoignit les émigrés d’Angleterre après la mort de Louis XVI. De retour en France en 1797, il servit dans les armées royales et catholiques du Bas-Anjou commandées par le comte de Châtillon. Après le retour de la Monarchie, François Syette fut nommé, par Louis XVIII, capitaine de cavalerie dans la garde du Roi (1815) puis chevalier de Saint-Louis. Il était le fils de Pierre-René Syette de la Villette, maire de Château-Gontier (1769-1771) et de Marie Planchenault des Planches. Il avait épousé Félicité Verdier de la Miltière et décéda en 1853.
En 1866, la ferme de l’Epau était occupée par Joseph Moreau, 60 ans, fermier, Julienne-Mélanie-Amélie Prézelain, 57 ans, sa femme, mariés à Quelaines le 21-6-1836, Emilie-Joséphine Moreau, leur fille, 29 ans, fermière, épouse de Jean Pateau, 39 ans, mariés à Quelaines le 16-10-1860, et leurs quatre enfants : Amélie, 5 ans, Marie, 4 ans, Jeanne, 3 ans, et Jean Pateau, 7 mois. La famille Moreau-Pateau employait deux domestiques : Marie Moreau, 16 ans, et Pierre Brunet, 59 ans.
En 1901, l’Epeau était habitée et exploitée par la famille Tauvry composée de Joseph-Henry Tauvry, 46 ans, fermier-patron, Adèle-Cécile Geslu, 43 ans, sa femme, mariés à Saint-Michel-de-la-Roë le 4-6-1882, Joseph Tauvry, 14 ans, leur fils, employé agricole, et Flavie Tauvry, 4 ans, leur fille. Joachim Jicados, 20 ans, était employé comme domestique de ferme.
Perrière (La). Ce nom désignant une carrière ou un endroit pierreux vient du latin petra, « pierre », avec suffixe -aria servant à désigner un lieu. La Perrière de Loigné était située à proximité de la Carrière (voir ce nom) citée en 1866.
Cette ancienne closerie fut vendue en 1771 par Michel Séguin (1726-1800, Azé), blanchisseur et négociant en toiles, à Pierre Guermond, tanneur, issu d’une famille qui possédait également la Cadeurie ou Cadurie (voir ce nom).
Michel Séguin avait épousé Catherine Guérin de Chavé à Azé le 15 janvier 1770 dont il eut Michel-Pierre-François Séguin, né en 1773, qui sera blanchisseur et négociant en toiles comme son père, deviendra, de 1822 à 1830, maire de Château-Gontier, et sera nommé
117
chevalier de la Légion d’honneur avant de décéder le 8 octobre 1859 à Château-Gontier.
A cette famille Séguin appartenait également Julien Séguin, « riche marchand et l’un des plus notables bourgeois de Château-Gontier » qui fut assassiné « à la campagne » en 1635 par Jean Guyard.
En 1866, la métairie de la Perrière, était habitée par Joseph Hacques, métayer, 31 ans, métayer, Sophie Monnoury, 28 ans, sa femme, Berthe Hacques, 2 ans, leur fille, et Adolphe Mainfray, 18 ans, domestique agricole.
En 1901, on y trouve René-Jean Landais, 46 ans, fermier-patron, Joséphine-Marie Raguet, 40 ans, sa femme, mariés à Villiers-Charlemagne le 30-11-1883, et Ernest Landais, 16 ans, leur fils, employé agricole.
Pescherie (La). Aussi orthographiée Pêcherie. Une pêcherie ou pescherie (en ancien français) désignait un élevage de poissons en eaux vives (ici la Mayenne). Ces élevages, au 15e siècle, « regorgeaient de poissons tels les becquets (brochets), l’alose, les carpes, les écrevisses et surtout le saumon. Ces derniers étaient si nombreux qu’une loi interdisait aux employeurs de personnes, nourries chez eux, de leur servir plus de deux repas de saumon par semaine » (Pierre Dauffy).
Dans un bois situé à proximité de ce lieu et proche de la Cadeurie (voir ce nom) s’élève depuis des milliers d’années le dolmen de la Pescherie aussi appelé dolmen de la Cadeurie ou la Pierre branlante. Cette construction mégalithique se compose d’une table en granit de forme elliptique d’une longueur de quatre mètres, supportée par deux blocs de pierre. La troisième pierre de support se trouve à proximité de l’édifice. Certaines stries présentes sur la pierre laissent penser qu’il servit de polissoir à nos ancêtres de la préhistoire. Ce dolmen était, à l’origine, couvert de terre et de pierres formant ce qu’on appelle un tumulus (sépulture). Une ancienne coutume voulait qu’une jeune fille voulant se marier dans l’année devait faire bouger ce colosse de pierre en une seule poussée d’où le nom de Pierre branlante.
« Tout près de ce dolmen, nous dit l’abbé Foucault, on rencontre un souterrain voûté, taillé dans le roc par la main des hommes ». Cette cavité artificielle pourrait avoir servi d’abri au garde chargé de surveiller la pêcherie puis plus tard (16e-17e siècles) de poste de garde aux Gabelous, préposés de la douane chargés de la surveillance du faux-saunage (contrebande du sel). Le faux-saunier (trafiquant de sel) risquait la prison à vie, les galères ou parfois la déportation dans les colonies françaises d’Amérique dont le Canada. Ainsi en 1731 et 1736, on signale l’envoi dans la province du Québec de deux faux-sauniers loignéens, Pierre et René Planchenault (voir la Sallerie).
Derrière l’élégante maison de la fin du 19e siècle aux allures de villa, on remarquera la présence de vieux murs de soutènement construit à la même époque.
En 1866, la Pescherie qui n’était qu’une simple closerie, était habitée par Jean-François Clavreul, 34 ans, domestique, Eugénie-Thérèse Blanchard, 30
118
ans, sa femme, mariés à Bazouges le 26-9-1858, Eugène Clavreul, 4 ans, leur fils.
En 1901, la Pescherie qui est devenue une villa, était occupée par Saint-Cyr Journeil, 66 ans, propriétaire-patron, qui employait un jardinier, Sylvain Hivert, 68 ans, et une cuisinière, Françoise Boulay, 70 ans, épouse Hivert.
Petit (Georges). Né le 26 mars 1888 à Chémeré-le-Roi, domicilié à Loigné à sa mobilisation. Caporal au 130e Régiment d’Infanterie. Mort pour la France à l’âge de 28 ans. Mort sur le terrain le 4 mars 1916 aux Maisons de Champagne (Marne).
Sépulture : Nécropole nationale de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, tombe n° 1307.
Pilardière (La). Ce nom désigne à l’origine le domaine agricole d’un certain Pilard, nom de famille issu de l’ancien français pile qui avait plusieurs sens : mortier, pilier, pilori, revers d’une monnaie, pilule. Le suffixe -ard a une connotation péjorative.
Entre 1720 et 1778, la Pilardière appartenait à la famille Jouanneau de Château-Gontier qui vendit le domaine à Jean Ferrand, sieur de Beaumont, orfèvre à Château-Gontier (1778). Celui-ci, fils de Jean Ferrand et de Marie-Anne Piau, épousa en 1733, en la paroisse Saint-Rémi de Château-Gontier, Catherine Destriché, fille d’Yves Destriché, également orfèvre, et de Catherine Guiouillier. De cette union naquirent Jean Ferrand (1735) et Catherine-Madeleine Ferrand (1736). Concernant la famille Destriché, voir la Bretonnerie, les Cormiers, la Crècherie.
En 1866, la Pilardière était habitée par Henri Cousin, 45 ans, propriétaire Cultivateur, et Perrine Bertron, 60 ans, sa nièce, veuve de Julien Fléchet, mariés à Loigné le 24-6-1820.
En 1901, on y trouve Jean-Baptiste Legrand, 39 ans, fermier-patron, Angèle-Marie-Louise Fraquet, 29 ans, sa femme, mariés à Argenton-Notre-Dame le 26-10-1890, leurs trois enfants, Angèle, 6 ans, Jean-Baptiste, 6 ans, Louis Legrand, 3 ans, et Joséphine Gadbin, 16 ans, domestique de ferme.
Pinson (Alexandre). Né le 14 mars 1888 à La Jaille-Yvon (Maine-et-Loire), domicilié à Loigné à sa mobilisation. Soldat de 2e classe au 117e Régiment d’Infanterie. Mort pour la France à l’âge de 30 ans. Mort le 2 janvier 1918 au lazaret II de Bayreuth (Allemagne) d’une maladie contractée en captivité. Sépulture : Nécropole nationale des prisonniers de guerre français de Sarrebourg (Moselle), tombe 6787.
Piquelière (La). Ce nom désigne à l’origine le domaine agricole d’un certain Piquet, nom de famille issu soit de l’ancien français piquer, « remuer la terre avec une houe », soit de l’ancien français piqueter, « faucher ». Le piquet, au moyen-âge, désignait une faux. Notre Piquet de Loigné était-il un faucheur ou un laboureur ?
Cette ferme fut mise en vente par la nation le 16 brumaire an IX (7 novembre 1800) sur Guillaume Giffard de Champagné, marquis, décédé avant 1817 à Château-Gontier. Il avait épousé le 28 avril 1764, à Château-Gontier, Marie-Anne Patry de Laubinière (1742-1817). Leur fils Guillaume-René Giffard de Champagné, né le 5 août 1766 à Château-Gontier, décédé le 27 juillet 1831 à Craon, avait épousé Adélaïde de Bonneval le 14 août 1790. Ancien capitaine d’artillerie, colonel honoraire, chevalier de Saint-Louis, était également seigneur de la Grande-Oresse (Montjean) et du Boulay (Cossé-le-Vivien).
La famille Giffard de Champagné possédait également en Loigné les fermes de la Crapaudière et de la Petite-Frézelière (voir ces noms).
En 1866, la Piquelière était exploitée par Jean Cousin, 53 ans, propriétaire cultivateur, et sa
119
femme Agathe Lemasle, 38 ans, mariés à Loigné le 16-2-1851. Ce couple employait deux domestiques de ferme : Pierre Doreau, 30 ans, et Marie Martel, 16 ans.
En 1901, on y retrouve Agathe Lemasle, alors âgée de 73 ans, fermière-patronne, qui était aidée dans les travaux domestiques par Marie Barré, 29 ans, veuve Cousin.
Places (Les Grandes et Petites). Le mot place vient du latin platea signifiant « espace plat » mais aussi « grande rue, place publique ». Dans le Maine et l’Anjou, la place (prononcée piace) désignait également une « haie d’épines entrelacées » (d’après le bas-latin palata, « enceinte de pieux de défense ». Nos places de Loigné désignaient-elles un ancien domaine clos de haies et de palissades ou un domaine fondé sur un lieu plat ? Ce lieu est situé sur un plateau (71 mètres d’altitude) qui domine la petite vallée du Bouillon ou de Marmouillé.
Dans un texte du 13e siècle, on cite un certain Hamelinus de Platea (Hamelin de la Place) qui fonda le prieuré de la Vernissière (voir ce nom).
En 1641, le domaine des Places fut vendu par René Vallin et Hélène Petiot à Gabriel Quantin, sieur de la Mitraie (Azé), avocat à Château-Gontier, issu d’une famille de magistrature castrogontérienne qui possédait également les Aillières d’Azé, la Viannière de Laigné et le Saulay.
En 1747, les Places appartenaient à Joseph Raffray, sieur du Buisson, issu d’une famille de notables de Château-Gontier, veuf d’Anne Gilles de Beaumont.
Par héritage, le domaine revint, avant 1780, à René Gilles de la Motte. La famille Gilles, originaire de Château-Gontier, était titrée de Beaumont (Daon), des Plantes (Bazouges) et de la Motte (Coudray). Elle était alliée aux familles Raffray, Ernault des Moulins (voir la Brichardière) et Douard (voir le Bouillon).
Le 25 mai 1794, on arrêta en ce lieu le fermier Lépine, Hallopeau et Louis Guinoiseau suspectés de Chouannerie.
En 1866, les Grandes-Places étaient exploitées par la famille Jarry dont Nicolas Jarry, fermier, 68 ans, Perrine Rezé, sa femme, 69 ans, mariés à Ménil le 7-9-1825, Auguste Seureau ou Sureau, 52 ans, domestique de ferme, et sa femme, Perrine Jarry, 32 ans, mariés à Ménil, le 9-6-1849. Louis Hocdé, 6 ans, était en nourrice.
Les Petites-Places étaient occupées par François-Jacques Legendre, 37 ans, fermier, Marie Poirier, sa femme, 33 ans, mariés à Loigné le 27-6-1865, Rosalie Legendre, 20 jours, et Marie Clavreul, 9 ans, fille de Marie Poirier.
En 1901, les Grandes-Places étaient habitées par Marie Rouiller, 63 ans, Pierre-Auguste Bigaret, 33 ans, fermier, Henriette-Victoire Rousseau, 31 ans, sa femme, mariés à Loigné le 12-1-1892, et Marie Bigaret, 8 ans, leur fille.
Les Petites-Places étaient exploitées par la famille Gouret composée de Pierre Gouret, 63 ans, fermier-patron, Philomène Bouvrie, sa femme, 50 ans, Marie Gouret, 17 ans, leur fille, et Ernest Gouret, 15 ans, leur fils, employés agricoles.
Planche (La). Cette ferme, située à la limite nord-est de la commune, doit son nom à un petit pont, une simple planche jetée sur le ruisseau de la Planche petit affluent de celui de la Guittonnerie qui forme la limite nord de la commune avec Saint-Sulpice.
En 1866, la Planche était exploitée et habitée par la famille Grimault composée de Pierre-Louis Grimault, métayer, 52 ans, Eugénie Gerbouin, sa femme, 52 ans, mariés à Loigné le 25-11-1845, Eugénie Grimault, leur fille, 17 ans, et Clément Grimault, 46 ans, frère de Pierre.
En 1901, on y trouve Michel Durand, 50 ans, fermier-patron, Marie Houdbine, 39 ans, sa femme, mariés à Houssay le 7-10-1879, et Marie Durand, 13 ans, leur fille.
120
Planchenault (Famille). Vieille famille de paysans connue à Loigné depuis le 17e siècle. Parmi les mariages Planchenault à Loigné, nous avons relevé ceux de :
- André Planchenault, né vers 1626, veuf de Michelle Collet, remarié à Loigné le 5-8-1684 avec Françoise Boutier, veuve de Pierre Brossard, marié en troisièmes noces le 26-6-1691 à Loigné avec Françoise Maingot, marié en quatrièmes noces à Loigné le 4-8-1696 avec Jeanne Moreau.
- Michel Planchenault, né vers 1654, fils de Michel et d’Anne Pottier, marié à Loigné le 21-10-1681 avec Jeanne Bodin.
- Jean Planchenault, né vers 1652, fils de Jean et de Michelle Véron, marié à Loigné le 1-8-1682 avec Jeanne Chalumeau.
- Jean Planchenault, né vers 1663, fils de Louis et de Jacquine Guermond, marié à Loigné le 6-2-1687 avec Sébastienne Fouassier.
- Joseph Planchenault, né vers1667, fils de René et de Marie Pottier, métayer au Petit-Fontenaille, marié à Loigné le 19-6-1692 avec Françoise Bertron, remarié à Loigné le 26-5-1709 avec Renée Clavreul.
- René Planchenault, né vers 1671, fils de René et de Marie Pottier, marié le 7-10-1694 avec Gabrielle Plantais.
- Pierre Planchenault, fils de Mathurin et de Nicole Mainfray, marié à Loigné le 3-7-1700 avec Renée Perrinet.
- Jean Planchenault, fils de Jean et de Gabrielle Clavreul, marié à Loigné le 14-1-1705 avec Renée Lalloyer.
- Marin Planchenault, né vers 1680, fils de René et de Marie Pottier, marié à Loigné le 17-9-1705 avec Louise Moreul, fille de Mathieu et de Louise Mottais.
- Jean Planchenault, né vers 1699, fils de Jean et de Sébastienne Fouassier, marié à Loigné le 14-2-1719 avec Perrine Bedin.
- René Planchenault, né vers 1692, fils de Michel et de Jeanne Bodin, marié à Loigné le 3-2-1722 avec Renée Lalloyer, veuve de Jean Planchenault.
- François Planchenault, né vers 1699, fils de René et de Gabrielle Plantais, marié à Azé le 21-4-1733 avec Jeanne Fouassier, remarié à Loigné le 18-7-1744 avec Renée Denis.
- François Planchenault, fils de René et de Gabrielle Plantais, laboureur à Loigné, marié à Saint-Sulpice le 20-6-1747 avec Jeanne Hamme.
- François Planchenault, né vers 1721, fils de Jean et de Perrine Bedin, marié à Loigné le 11-10-1746 avec Jeanne Véron.
- Jean Planchenault, né vers 1731, fils de Jean et de Perrine Bedin, marié à Loigné le 10-11-1750 avec Michelle Bodinier, remarié à Loigné le 8-2-1763 avec Julienne Meignan.
- Jean Planchenault, né vers 1722, fils de Jean et de Renée Lalloyer, marié à Loigné le 16-2-1751 avec Jacquine Cartin.
- Pierre Planchenault, fils de Jean et de Perrine Bedin, marié à Loigné le 30-1-1759 avec Perrine Corbin.
- Michel Planchenault, fils de François et de Renée Davy, marié à Loigné le 25-11-1776 avec Julienne Fouassier.
- Pierre Planchenault, fils de François et de Jeanne Hamme, marié le 10-11-1789 avec Marie Pottier.
- Pierre Planchenault, fils de François et de Jeanne Fouassier, marié à Loigné le 21-10-1781 avec Perrine Thoreau, fille de Michel et Perrine Planchenault.
- Pierre Planchenault, né vers 1771, fils de François et de Michelle Denouet, marié à Loigné le 13-5-1793 avec Perrine Pécheux.
- Jean Planchenault, né vers 1753, fils de Jean et de Michelle Bodinier, marié à Loigné le 29-6-1800 avec Marie Beton.
121
- René Planchenault, né vers 1781, tonnelier à Sant-Sulpice, fils de Jacques et de Marie Robin, marié à Loigné le 20-4-1805 avec Jeanne Richard.
- François Planchenault, né à Nuillé-sur-Vicoin le 30-8-1757, laboureur à Loigné, fils de Pierre et de Renée Girard, marié à Loigné le 28-1-1804 avec Marie Cherruau.
- Pierre Planchenault, né à Loigné le 8-11-1783, fils de Pierre et de Perrine Thoreau, marié à Loigné le 6-6-1812 avec Perrine Gastineau.
- Jacques Planchenault, né à Bazouges le 7-4-1793, laboureur à Loigné, fils de Jacques et de Marie Lemasle, marié à Loigné le 17-7-1827 avec Ambroise Prioux, remarié à Loigné le 9-9-1834 avec Marie Aubigné.
- Jean Planchenault, né à Loigné le 25 août 1794, fils de Jean et de Perrine Pescheux, marié à Loigné le 11-10-1840 avec Sophie-Perrine Deslandes.
- Jean-Pierre Planchenault, né à Marigné-Peuton le 24-6-1819, fils de Jean et de Marie Després, demeurant à Loigné, marié à Loigné le 18-4-1842 avec Perrine Clavreul.
- Pierre-Jean Planchenault, né à Méral le 25-9-1808, laboureur à Loigné, fils de Louis et de Renée Beaudouin, marié à Loigné le 28-1-1850 avec Jacquine Laloge.
- Pierre Planchenault, né à Loigné le 4-8-1812, laboureur, fils de Pierre, décédé à Loigné le 24-7-1835, et de Perrine Gastineau, marié à Loigné le 23-4-1854 avec Françoise Fouassier.
- Jean Planchenault, né à Azé le 16-6-1828, fils de Jean, laboureur à Loigné, né vers 1792, et de Joséphine Durand, marié à Loigné le 7-4-1861 avec Louise-René Rouillère.
- Eugène-Joseph Planchenault, né à Saint-Sulpice le 7-5-1858, domestique-cultivateur à Fontenailles, fils de René, décédé à Bazouges le 8-1-1878, et de Joséphine Grippon, marié à Loigné le 4-7-1881 avec Marie-Pauline Richard.
Planchenault (Auguste). Né le 20 juillet 1894 à Marmouillé de Loigné, fils de Jean, Louis Planchenault, cultivateur, et d’Augustine Besnier. Soldat de 2e classe au 115e Régiment d’Infanterie. Mort pour la France à l’âge de 21 ans. Tué à l’ennemi le 28 septembre 1915 à l’Epine de Vedegrange (Marne).