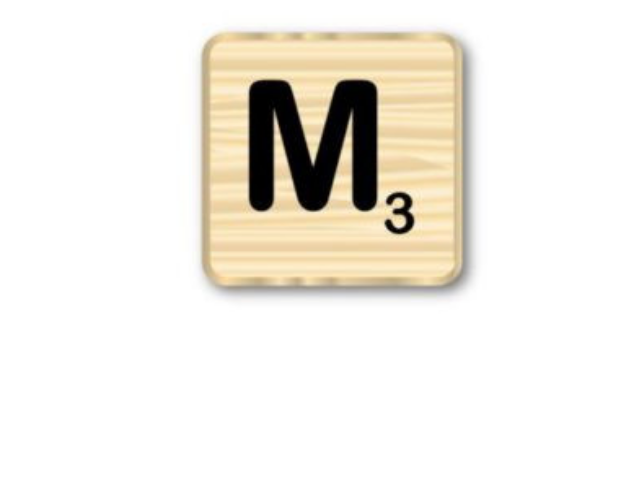
Monceaux (Les Grands et Petits). Ce lieu doit son nom à son relief. Le latin monticellum, diminutif de mons, « montagne, colline », est à l’origine de l’ancien français moncel, « colline ». Les Monceaux désignent ainsi un endroit composé de petites collines.
Cette ancienne terre seigneuriale avec château relevait des seigneurs de la Maroutière (Saint-Fort), qui étaient quant à eux des vassaux des seigneurs de Château-Gontier. C’est pour cela qu’en 1399, le seigneur de la terre des Monceaux devait à son arrière-suzerain de Château-Gontier 15 jours de garde à la porte fortifiée de sa ville pour acquitter son droit de haute justice, franchise et coutume des denrées… La haute-justice désignait le droit de vie et de mort accordé à un seigneur sur ses sujets, la franchise l’exemption de paiement accordé à un seigneur sur certains produits vendus dans les commerces ou les marchés d’une ville, et la coutume des denrées, le droit accordé aux sujets d’un seigneur de s’installer librement sur les marchés d’une ville pour vendre leurs produits.
En 1384, le domaine des Monceaux appartenait à Agathe des Monceaux qui rendit aveu de sa terre au seigneur de la Maroutière. Elle avait épousé Jean de Cuillé avant 1380. Leur fils, Jean de Cuillé, était seigneur des Monceaux en 1402. Il déclara, cette année-là, à son suzerain « le fief de Longné à présent appelé la haute justice des Monceaux ». Sa veuve, Jamette de la Rochère, avouait à son suzerain, le seigneur de la Maroutière et de Loigné, « son herbergement des Monceaux, partie du domaine et estrages, cens et rentes, justice et vaerie moyenne et basse vaerie, juridiction et seigneurie foncière, droit de pendre et essorillier pour cas de larrecins et omicides, mesures à blé, à vin, espaves, amende et pressoirage ».
En 1430, les Monceaux revinrent à Jeanne de Cuillé, épouse de Marin Crespin. Hilaire de Cuillé lui succéda avant 1436. Celui-ci fut tué accidentellement en 1473 aux Monceaux par Jean Chevrollier au cours d’une partie de tir à l’arc.
A sa suite, nous trouvons comme seigneurs des lieux : Jean de Cuillé, époux de Jeanne de Poncé, 1477, 1538, Claude de Cuillé, 1452, époux de Marie Bonvoisin (veuve en 1587). La famille Bonvoisin possédait également à cette époque la terre d’Aviré (voir ce nom). Leur fils, Claude de Cuillé, baptisé à Fromentières en 1550, époux de Françoise de Cordon, était décédé en 1616 puisque ses enfants, orphelins de père, avaient pour curateur, à cette date, René de Cordon, seigneur de Bois-Bureau (La Cropte), époux de Françoise de Vignolles, zêlé huguenot qui s’empara de la ville du Mans en 1562.
En épousant Elisabeth de Cuillé, avant 1634, Charles de Villeprouvée devint seigneur des Monceaux. C’est ce dernier qui, en 1634, rendit aveu au seigneur de Château-Gontier du « domaine et hébergement des Monceaux,… droit de poustau à carcan au bourg de Loigné, mesures, espaves, aubenage, deshérence, quintaine, prisons, amendes, coustumes, chasse à toute sorte de gibiers, droit de banc en l’église près l’autel Notre Dame, sépulture dessous le banc, droits honorifiques après le seigneur fondateur ».
Charles de Villeprouvée se vit saisir de sa terre des Monceaux en 1646. Il décéda avant 1653.
En 1654, Lancelot de Quatrebarbes (voir Fontenailles, Fontenelle, les Bordeaux et Viaulnay) acheta les Monceaux à Suzanne de Villeprouvée. Son épouse, Louise de Savonnières, fit son testament aux Monceaux en 1660. Dans ce testament, elle signale « l’euche (prairie) dessus les mottes des Monceaux » Ces « mottes » rappellent le relief et l’origine du nom de ce lieu.
A Lancelot de Quatrebarbes succédèrent Charles de Quatrebarbes et sa sœur Louise-Madeleine qui vendirent, en 1701, les Monceaux à Charles Meignan, sieur de Malabry. Concernant la famille Meignan voir Malabry et la Martellière.
Le domaine fut ensuite acheté par Louis-François Amellant (voir Beauvais), sieur de la Parfaiterie (Anjou), époux de Cunégonde-Barbe du Moulin. Ceux-ci, décédés respectivement en 1748 et 1771, laissèrent la terre des Monceaux à Jeanne-Louise Amellant, née en 1741, et Cunégonde-Barbe Amellant, décédée en 1795 à Château-Gontier. Cette dernière, par son mariage en 1765 avec Gervais Couppel du Lude (voir Beauvais), fit passer la terre des Monceaux dans cette famille. De leur union naquirent Louis-Jean, Agathe-Louise-Madeleine-Victoire (née en 1776) et Daniel-Siméon-Brice Couppel du Lude (né en 1770).
Ce dernier émigra à la Révolution. Il revint en France après le débarquement avorté des émigrés à Quiberon en juillet 1795 qui se termina dans un bain de sang : 167 nobles et royalistes fusillés à Quiberon, 206 à Auray et 374 à Vannes. Fuyant ces massacres, Daniel Couppel du Lude fut arrêté le 22 octobre 1796 à Ploërmel et conduit à la prison de Laval le 12 décembre. Libéré des geôles lavalloises et muni d’un passeport pour l’étranger, il embarqua pour l’Angleterre à Saint-Malo. De retour à Laval en octobre 1797, il fut une nouvelle fois emprisonné jusqu’au 16 novembre 1798 puis transféré dans les prisons de Rochefort. Il décéda à Loigné le 26 janvier 1839. Il avait épousé, le 20 février 1813, Aimée-Marie du Préaulx.
Leur fils, Siméon-Amaury-Tancrède Couppel du Lude, né à Loigné le 11 mai 1815, mourut le 28 octobre 1854, à l’âge de 39 ans, en Ukraine au cours du siège de Sébastopol lors de la Guerre de Crimée. Il était alors capitaine de la 2e Compagnie de Zouaves. Il avait épousé à Mortagne (61), en 1850, Louise d’André de Saint-Victor dont il eut Raoul Couppel du Lude, futur maire de Loigné et préfet de l’Orne. (Voir Couppel du Lude). La famille Couppel du Lude a toujours son monument funéraire dans l’actuel cimetière de Loigné.
Délaissé et abandonné après la Révolution, le château et les dépendances des Monceaux tombèrent en ruine et ses pierres servirent à la construction du nouveau logis de la famille Couppel du Lude connu actuellement sous le nom des Touches, à la rénovation de ses fermes et à l’encaissement de ses chemins. Triste fin pour une demeure aussi prestigieuse mais, à l’époque, on ne se souciait pas encore du patrimoine et de son histoire.
En 1846, on signale la maison de maître des Monceaux (aujourd’hui appelée les Touches) qui était habitée par Scholastique Couppel du Lude, 46 ans, et Noémie Couppel du Lude, 41 ans, propriétaires, qui employaient trois domestiques : Marie Guermon, 24 ans, Adélaïde Bieslin, 19 ans, et Jean Chauvin, 41 ans.
Seules survécurent au nom deux fermes les Petits et les Grands-Monceaux. Cette dernière, selon les dires de M. Antoine Gouabau, actuel propriétaire des Touches, conserverait dans ses soubassements les traces d’anciens murs, fondations mêmes de la forteresse des Monceaux.
En 1866, on signale le Domaine des Monceaux (de nos jours les Petits-Monceaux)exploité et habité par la famille Gaudray composée de René Gaudré, 66 ans, fermier, Marie Girandier, sa femme, 64 ans, mariés à Bazouges le 11-11-1837, Charles Gaudré, 26 ans, leur fils, et Marie Gaudré, 24 ans, leur fille, et les Monceaux (devenu les Grands-Monceaux) habités par la famille Péan composée Pierre Péan, 42 ans, fermier, veuf, ses filles Marie, 9 ans, Victorine, 7 ans, son fils Pierre Péan, 6 ans. Pierre Péan père employait quatre domestiques : Pierre Planchard, 40 ans, Pierre Béchu, 31 ans, Elie Guermont, 14 ans, et Marie-Jeanne Giboire, femme de Pierre Gohier, 30 ans, mariés à Marigné-Peuton le 5-7-1863..
En 1901, on y retrouve la famille Gaudré avec Charles Gaudré, 61 ans, fermier-patron, Joséphine-Sophie Chrétien, 52 ans, sa femme, mariés à Loigné le 10-6-1873, Charles Gaudré, 27 ans, fermier, leur fils, Constance Bruand, 31 ans, sa femme, mariés à Houssay le 2-6-1896, et leurs enfants Charles, 3 ans, Joséphine, 2 ans, Victor et Marie Gaudré, des jumeaux âgés d’un an. Louise Cadot, 14 ans, était domestique.
L’autre ferme des Monceaux était exploitée par la famille Ledroit composée d’Ambroise-Georges Ledroit, 51 ans, fermier-patron, Marie-Joséphine Rousse, 42 ans, sa femme, mariés à Bazouges le 9-11-1877, Ambroise Ledroit, 23 ans, leur fils, employé agricole, et Marie Ledroit, 19 ans, leur fille, employée agricole. Victor Bourbon, 15 ans, était alors leur domestique de ferme.
Mon Désir. Cette appellation est de formation récente (début du 20e siècle) et rejoint les appellations peu originales telles que Mon Idée, Monconseil, Sam Suffit, Monplaisir… Cette maison construite en bordure de la route de Marigné-Peuton, à l’extrême limite ouest de la commune de Loigné, n’a rien de remarquable si ce n’est son imposante croix en fer du calvaire, œuvre d’un habile artisan ferronnier. « Ce type de croix est assez rare car le métal exige de la part de l’artisan une bonne maîtrise du matériau ainsi qu’un certain talent pour créer une œuvre originale et unique » (Le Patrimoine des communes de la Mayenne, Flohic-Editions, 2002).
Monnerie (La). Bien que d’aspect moderne, cette maison a remplacé une ancienne ferme citée par le cartographe Cassini au 18e siècle sous le nom de la Monerie. Elle apparaît encore sur le plan cadastral de 1833. Ce lieu doit son nom soit à une famille Monier, Monnier ou Le Monnier, nom de famille désignant à l’origine le meunier ou monier dans les parlers du Maine, soit à un ancien moulin à eau situé sur le ruisseau de la Chardonnière. Signalons qu’une famille Lemonnier ou Le Monnier vivait à Loigné au 17e siècle : René Lemonnier, fils de Jean Lemonnier et de Jeanne Véron, né vers 1659, qui épousa à Loigné le 8-7-1684 Jacquine Sureau puis, le 6-7-1694, Marie Bodin ; Marie Lemonnier, fille de Pierre Lemonnier et de Marie Meignan, née vers 1652, qui épousa à Loigné le 26-11-1692 Jean Bodin.
Quoiqu’il en soit de l’origine exacte de ce nom de lieu, il va de soit qu’il a un lien certain avec la mouture de céréales. La monée ou moniée, dans le Bas-Maine (Mayenne), désignait « la quantité de grain que l’on mettait une fois au moulin » et la monerie, en ancien français, la mouture et le droit sur la mouture.
Une petite histoire mayennaise raconte qu’à l’enterrement d’un monier (meunier) trois animaux suivent le convoi funèbre : le coq qui chante « monier, restitue ! », la cane qui caquette « pas prêt, pas prêt ! » et la bique qui bêle « jamais, jamais ! ». Cette petite histoire humoristique pour rappeler que les meuniers n’étaient pas tous d’honnêtes citoyens. Effectivement, certains meuniers détournaient une partie de la mouture que lui apportait le paysan en employant le système de la meule à point carré. « La boîte à archure (ou coffre de bois contenant les deux meules) un peu plus grande que la normale permettait de conserver dans les angles et sans qu’elle rejoignit la mouture tombant sous les meules, quelques livres de farine qui restaient ainsi conservées au profit direct du meunier en plus de sa rétribution par un droit de mouture » (Jean-Pierre Bauchet).
En 1866, la Monnerie était habitée par la famille Dudouet avec Jean Dudouet, 47 ans, fermier, Adélaïde Lainé, 45 ans, sa femme, mariés à Saint-Michel-de-Feins le 16-6-1848, et Jean Dudouet, leur fils, 11 ans.
En 1901, on y trouve Adèle Piray, 53 ans, fermière-patronne, ses deux enfants, Eugène, 22 ans, et Hélène Piray, 20 ans, employés agricole, et Françoise Piray, 73 ans.
Monument-aux-Morts. (Square de la Mairie). Ce monument dressé près de la Mairie en 2008, sous le mandat de Pierre Jégouic, a remplacé un ancien monument qui avait été élevé
dans le cimetière en 1920.
Y sont inscrits 31 noms correspondant aux morts pour la France lors des conflits de 1914-1918, 1939-1945 et d’Algérie : Bertron Eugène, Bichot Alphonse, Bourny Francis, Bouverie Louis, Bruchet Paul, Ciron Auguste, Clavreul Jean-Baptiste, Cornuaille Henri, Dalibard Baptiste, Dreux Eugène, Ferron Jean-Baptiste, Gaudret Charles, Gérard Alexandre, Guyard Louis, Hamelin Joseph, Hocdé Emile, Huaumé Joseph, Huneau Albert, Journeault Henri, Lecomte Raymond, Legrand Jean-Baptiste, Lemesle François, Paillard Augustin, Petit Georges, Pinson Alexandre, Planchenault Auguste, Plot Joseph, Pointeau Jacques, Rouillère Auguste, Sézille Evariste, Véron Edouard (voir ces noms).
Moreau (Famille). Vieille famille de paysans connue à Loigné depuis le 17e siècle. Parmi les mariages Moreau à Loigné, nous avons relevé ceux de :
- René Moreau marié avant 1687 avec Françoise Saulou, père de Françoise mariée à Loigné le 8-7-1704 avec Madelon Véron.
- Nicolas Moreau, né vers 1711, fils de Georges et de Marie Seneau, marié à Loigné le 26-2-1743 avec Louise Blanchet.
- Julien Moreau, fils de Pierre et de Marie David, marié à Loigné le 16-11-1751 avec Marie Chevalier, remarié le 29-10-1770 avec Jeanne Meignan.
- Olivier Moreau, fils de François et de Françoise Anjuère, tisserand, marié à Loigné le 15-7-1777 avec Renée Bertron, fille de Pierre et de Renée Taunay.
- Pierre Moreau, veuf de Jeanne Thuau, remarié à Loigné le 22-8-1780 avec Marie Valleray.
- Jean Moreau, né vers 1757, fils de Jean et de Marie Rabeau, marié à Loigné le 25-2-1783 avec Madeleine Ciron.
- Jacques Moreau, fils de Guillaume et de Marie Gaudré, marié à Loigné le 7-7-1789 avec Jacquine Halopeau.
- François Moreau, né vers 1760, fils de Jean et de Marie Rabeau, marié à Loigné avec Françoise Ciron.
- Jean Moreau, né le 28 septembre 1747 à Villiers-Charlemagne, fils de Pierre et de Louise Chevrollier, marié à Loigné le 5-7-1802 avec Catherine Prioux.
- Louis-Pascal-Pierre Moreau, né à Loigné le 17 mars 1787, fils d’Olivier et de Renée Bertron, marié à Loigné le 23-11-1811 avec Charlotte-Louise-Jeanne Lalloyer.
- Guillaume Moreau, né à Loigné le 23-10-1795, fils d’Olivier et de Renée Bertron, marié à Loigné le 25-11-1816 avec Marie-Anne Poirier.
- Jean Moreau, né à Loigné le 15-8-1784, fils de Jean et de Madeleine Ciron, marié à Loigné le 24-11-1823 avec Michelle-Marie Hermenier.
- Louis Moreau, né à Loigné le 19-10-1830, fils de Louis et de Mathurine Annet, marié à Loigné le 20-6-1858 avec Henriette Beyer.
- Jean-Louis Moreau, né à Loigné le 25-8-1839, fils de Louis et de Mathurine Annet, marié à Loigné le 19-4-1868 avec Perrine-Jeanne Bodin.
- François-Henri Moreau, né à Bouillé-Ménard (49) le 5-6-1861, fils de François et de Marie Houtin, marié à Loigné le 5-6-1887 avec Marie-Elise Viel.
Moreul (Famille). Vieille famille de paysans et de maréchaux-ferrants connue à Loigné aux 17-18e siècles. Parmi les mariages Moreul à Loigné, nous avons relevé ceux de :
- René Moreul, né vers 1664, fils de René et de Renée Guinoiseau, marié à Bazouges le 31-8-1690 avec Charlotte Barrier, remarié à Loigné le 2-6-1693 avec Claude Martineau, marié en troisièmes noces à Loigné le 21-10-1694 avec Jeanne Gomier.
- Mathurin Moreul, fils de Mathurin et de Geneviève Doussin, marié à Loigné le 29-9-1693 avec Jacquine Rabeau.
- Michel Moreul, né vers 1674, fils de Mathurin et de Geneviève Doussin, marié à Loigné le 17-2-1694 avec Anne Gautier.
- Pierre Moreul, né vers 1661, baptisé à Bazouges, marié à Loigné le 14-2-1695 avec Marie Chapelier, remarié à Loigné le 16-6-1697 avec Renée Guérin.
- Jean Moreul, fils de Mathurin et de Geneviève Doussin, maréchal à Loigné, marié à Saint-Germain-de-L’Hommel le 28-1-1698 avec Marie Lezé, remarié à Loigné le 26-11-1711 avec Julienne Fouassier.
- Mathurin Moreul, né vers 1698, fils de Mathurin et de Jacquine Rabeau, marié à Loigné le 4-10-1740 avec Renée Lezé.
- François Moreul, né vers 1715, fils de Mathurin et de Jacquine Rabeau, marié à Loigné le 12-10-1745 avec Françoise Garnier, remarié à Loigné le 1-8-1752 avec Marie Pottier.
- Jean Moreul, né vers 1716, fils de Jean et de Julienne Fouassier, maréchal à Loigné, marié à Saint-Rémi de Château-Gontier le 24-11-1744 avec Jacquine Rabeau.
- François Moreul, fils de Jean et de Jacquine Rabeau, décédé à Château-Gontier en 1796, marié à Loigné le 22-1-1782 avec Perrine Chesneau.
- Jean Moreul, né vers 1748, fils de Jean et de Jacquine Rabeau, marié à Loigné le 8-11-1773 avec Anne Serru.
- Jacques Moreul, fils de Jean et de Jacquine Rabeau, marié à Loigné le 12-2-1778 avec Jacquine Priet.
- Guillaume Moreul, fils de Jean et de Jacquine Rabeau, marié à Loigné le 7-2-1785 avec Françoise Bertron.
- Pierre Moreul, fils de Jean et de Jacquine Rabeau, marié le 17-1-1781 avec Françoise Moreul, fille de François et de Marie Pottier.
- François-Jean Moreul, né à Château-Gontier le 3-1-1796, fils de François et de Perrine Chesneau, maréchal à Loigné en 1815, marié à Loigné le 21-9-1815 avec Pélagie-Julienne Chevrollier.
Moreul (François). Né le 18 avril 1754 à Loigné, fils de Jean (1714-1776), maréchal-ferrant, et de Jacquine Rabeau (1729-1812). Décédé le 18 nivôse an IV (8 janvier 1796) à Château-Gontier « des suites de l’assassinat commis sur sa personne par les Chouans ». Ce fermier de la Haute-Croix avait été nommé capitaine de la Garde nationale quand il fut sabré par le chouan « La Fiole ». Voici son acte de décès rédigé à l’époque :
« Aujourd’hui dix huit Nivose l’an quatre de la République une et indivisible à dix heures du matin Devant moi Louis-François Lavenard, membre de l’administration municipale de la commune de Château-Gontier, chef-lieu d’arrondissement, département de la Mayenne, chargé de constater l’état civil des Citoyens, ont comparus les citoyens Pierre Moreul, cultivateur sur la commune de Loigné et réfugié dans Bazouges, âgé de trente sept ans, et Gorges Le Vayer, , officier de santé, âgé de cinquante ans, domicilié de cette commune, lesquels m’ont déclaré que François Moreul, âgé de quarante et un ans, frère du déclarant, aussi cultivateur au dit Loigné, mari de Perrine Chéneau, fils de feu Jean Moreul, maréchal, et de Jacquine Rabeau, est décédé ce jour, deux heures du matin au faux bourg de Treshut de cette commune des suites de l’assassinat commis sur sa personne par les Chouans. D’après cette déclaration, m’étant assuré du décès, j’ai dressé le présent acte en présence des déclarans qui ont signé avec moi. Fait à la maison commune du dit Château-Gontier par moi officier de l’état civil, les jour et an ci-dessus (signé) P. Moreul , G. le Vayer, Lavenard, officier municipal.
François Moreul avait épousé, le 22 janvier 1782 à Loigné, Perrine-Magdeleine Chesneau dont il eut quatre enfants : Françoise (née en 1782), Jacquine (née en 1786), Jeanne (née en 1788) et François-Jean (né en 1796) qui héritèrent de la ferme de la Haute-Croix (voir ce nom).
Moreul (Guillaume). Frère du précédent, né le 30 septembre 1750 à Loigné, marié à Loigné le 7 février 1785 avec Françoise Bertron dont il eut sept enfants : Françoise, née en 1785, Guillaume, né en 1786, Françoise, née en 1788, Joseph et Guillaume, nés en 1789, François, né en 1792, et Jean, né en 1794 ; tous nés à Loigné.
Ce marchand et fabricant de tuiles assurait la fonction de secrétaire-greffier au sein de la municipalité de Loigné, lorsqu’il dut se réfugier à Château-Gontier, le 24 mai 1795, à cause des Chouans. Il ne revint à Loigné qu’au cours de l’année 1796.
Moreul (Jacques). Frère du précédent, né le 25 avril 1752, décédé le 26 janvier 1805 à Loigné, marié à Loigné le 10 février 1778 avec Jacquine Périet (1751-1803) dont il eut six enfants : Jacques, né en 1779, Jacquine, née en 1781, Jeanne, née en 1784, Renée, née en 1787, Françoise, née en 1789, et Marie, née en 1798 ; tous nés à Loigné.
Le 31 décembre 1796, ce maréchal-ferrant de Loigné fut forcé de creuser une fosse pour y enterrer le corps de Pierre Boiramé dans un champ de la Haute-Croix (voir ce nom).
Moreul (Jean). Frère aîné du précédent, né le 11 avril 1746 à Loigné, décédé le 15 septembre 1797 à Fromentières, marié à Loigné le 8 novembre 1778 avec Anne Serru dont il eut cinq enfants : Jeanne, née en 1774, Anne, née en 1775, Jean, né en 1777, Louise, née en 1778, et Marie, née en 1798 ; tous nés à Fromentières. Il exerçait, comme son père, le métier de maréchal-ferrant.
Moreul (Pierre). Frère du précédent, né le 28 octobre 1758 à Loigné, marié le 17 janvier 1786 à Loigné avec Françoise Moreul, sa cousine, née en 1766, dont il eut six enfants : Françoise, née en 1786, Perrine, née en 1787, Pierre, né en 1788, Jacquine, née en 1790, Marie, née en 1792, et François, né en 1794 ; tous nés à Loigné. C’est lui qui ramena à Château-Gontier, le 8 janvier 1796, le corps de son frère François.
Morillands (Les). L’origine du nom de ce lieu reste aussi mystérieuse que son lointain passé. Trois origines sont envisageables : soit il s’agit d’un toponyme d’origine gauloise ou gallo-romaine formé à partir du préceltique mor, « butte », du nom d’homme gaulois Ilius ou Illius et du suffixe -anum ; soit du même préceltique mor, « butte », ajouté à Andi, nom latin désignant les Andes ou Andécaves, peuple celte qui est à l’origine de la ville d’Angers et de l’Anjou ; soit, selon l’abbé Foucault, il s’agirait d’une variante du mot latin morientes, « mourant » prit dans le sens de « détruit, anéanti ».
Quoiqu’il en soit, il est établi de nos jours qu’un peuple celte (Andécaves, Namnètes ou Cénomans) édifia un oppidum (ville fortifiée) sur ce plateau dominant la rivière. Des photographies aériennes ont révélé les traces d’un rempart de terre et de nombreuses fermes datant de la fin de la période gauloise. Au 19e siècle, on y signalait « quantité de ruines et de vieux murs enfoncés sous la terre, se croisant dans tous les sens ». On y a découvert des monnaies gauloises dont un statère d’or attribué aux Cénomans (peuple celte vivant sur une partie des départements de la Sarthe et de la Mayenne et dont la capitale était la ville du Mans). On a également découvert une hache en bronze qui fut déposée au musée de Laval.
Après 52 av. J.C., après la conquête romaine, les gallo-romains continuèrent à vivre sur le plateau des Morillands ou on signalait, encore au 19e siècle, une ferme appelée la Cité (du latin civitas, ensemble des citoyens d’une ville). L’abbé Foucault dans son ouvrage « Documents sur Château-Gontier » (1883) raconte que « d’après une tradition constante, et qui paraît des plus solidement établie, une ville, habitée par une peuplade celtique, s’élevait autrefois… sur un plateau nommé les Morillands, et une ferme appelée encore de nos jours la Cité, sert à en perpétuer le souvenir d’âge en âge ».
En 852, après le pillage d’Angers par les Normands, les vikings remontèrent la Mayenne grâce à leurs drakkars et pillèrent les monastères d’Azé, d’Entrammes, de Priz, de Saint-Jean-sur-Mayenne, de Mayenne et d’Evron. On peut supposer qu’ils détruisirent et incendièrent également la cité des Morillands si l’on en croit l’abbé Foucault : « Des pierres calcinées, des poutres à demi-consumées, que l’on rencontre çà et là sous terre, à une certaine profondeur, attestent que cette ville dut être détruite par un incendie… ».