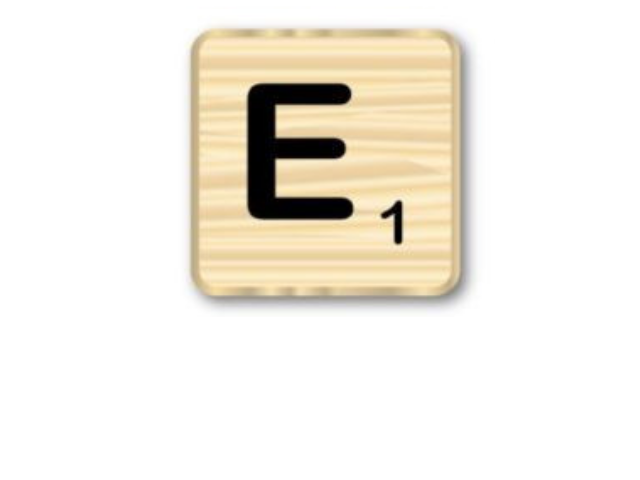
Ecoles. Loigné possédait, au 19e siècle, deux écoles.
La première, l’école laïque pour les garçons qui existait déjà en 1830, année où le 19 janvier M. Andrieu d’Allas, recteur de l’Académie d’Angers, autorisait M. Jean Cotton, de Saint-Fort, instituteur primaire muni d’un brevet de 3e degré, et sa femme, Perrine Cotton, à enseigner les enfants de Loigné. En 1831, cette maison d’école menaçait « ruine de tous côtés ». Elle était située sur le chemin vicinal de la Roche, à cinquante mètres de l’église. Elle était « entourée au nord par la cour de récréation, spacieuse mais froide en hiver, et au sud par un grand jardin, le seul agrément de toute l’habitation ». En cette même année, le conseil municipal, à une voix de majorité, décidait la construction d’une nouvelle maison d’école. Mais il n’y eut pas de suite à cette décision. Il fallut attendre le 13 juillet 1841 pour que le projet soit remis sur la table par le maire, M. Misière fils, et son conseil municipal. Un terrain fut acheté par la commune à proximité de l’ancienne école et, le 22 mai 1842, le conseil municipal acceptait un plan de M. Rolland, architecte à Château-Gontier. Le devis s’élevait à 5690 francs. Les travaux commencèrent le 13 mai 1843 pour s’achever le 30 septembre. Cette maison, qui servit également de Mairie, comprenait, au rez-de-chaussée, une grande classe rectangulaire, une cuisine et une laverie. Au premier étage, se trouvait une salle réservée à la Mairie, deux chambres pour les instituteurs et un cabinet. Dans la cour un petit préau couvert avec deux WC fut également construit. Le 13 octobre 1843, M. Ballu, ancien élève de l’Ecole normale et instituteur à la Chapelle-Craonnaise, fut autorisé par le recteur de l’Académie d’Angers, à enseigner les garçons et les filles de la commune. L’école restera mixte jusqu’en 1861. Le 22 octobre 1843, le conseil municipal votait une somme de 393 francs pour l’achat de mobilier scolaire.
Liste des premiers instituteurs de l’école de garçons de Loigné :
- M. Ballu (1843-1855), M. Fayet (1855-1859), M. Henri Lion (1859-1865), M. Paul Bouilly (1865-1875), M. Brault (1875), M. René Bescher (1875-1885), M. Victor Riou (1887-1887), M. Turcan (1887-1888), M ; Georges Emery (1888-1891), M. Alexis Foubert (1891-1896), M. Célestin Mautaint (1896-1908) et Marguerite Floch (1906), Joseph Bothet et Estellie Jolly (1911).
Les effectifs étaient de 40 élèves en 1888, 42 en 1889, 40 en 1890, 35 en 1891, 38 en 1892, 35 en 1893, 36 en 1894, 30 en 1895, 27 en 1896, 28 en 1897.
(Photo : La façade nord de l’école des garçons d’après le plan de M. Rolland, architecte, 1842).
En 1991-1992, un nouveau groupe scolaire, baptisé du nom de « la Roche-Fleurie », a vu le jour derrière l’ancienne mairie-école qui a été démolie en août 2013 pour la construction du restaurant scolaire. Une extension eut lieu en 2007 (salle plurivalente, création d’une 3e classe) ; elle fut suivie, en 2011-2012, par la construction d’une école maternelle (2 classes), et du restaurant scolaire (2e semestre 2013-début 2014). La direction de ce groupe scolaire, qui regroupe les élèves de Loigné et de Marigné-Peuton, fut confiée à Mme Mireille Mazéas (jusqu’en juin 2013) puis à M. Pascal Bresteaux (à partir de septembre 2013). Les effectifs étaient de 110 élèves en 2004, 125 en 2005, 134 en 2006, 130 en 2008, 121 en 2009, 127 en 2010, 131 en 2011, 128 en 2012 et 121 en 2013. En 2013, les effectifs se répartissaient ainsi : 17 élèves en Petite section, 23 en Grande et Moyenne section, 26 en CP et CE1, 28 en 27 en CE1/CM1, et 28 en CE2/CM2.
(Photos : démolition de l’ancienne Mairie-école et construction du restaurant scolaire, 2013).
L’école publique de filles ne fut créée qu’en 1861. Elle se trouvait sur la route de Quelaines à 30 mètres au nord de l’église. Le 24 décembre 1854, le conseil municipal décidait de vendre le petit cimetière situé au nord de l’église. Sur une partie de ce petit cimetière s’éleva une maison qui devint un café. M. Alphonse Homo, curé de Loigné de 1856 à 1870, acheta cette maison qu’il donna à la communauté des sœurs de Briouze (Orne). En 1861, des sœurs vinrent s’établir dans cette maison afin d’y fonder une école publique de filles. En 1899, l’école de filles comptait 46 élèves, âgées de 6 à 13 ans. En 1902, à cause des lois de laïcisation, l’école fut fermée et les sœurs de Briouze durent partir à l’étranger (Belgique, Hollande, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada).
Institutrices congrégationnistes : sœur Françoise Meunier et sœur Marie Grosos (1866), sœur Anne Guesdon et sœur Clémentine Leclair (1872), sœur Anne Guesdon et sœur Philomène Moussay (1876, 1881), sœur Anne Guesdon, sœur Philomène Moussay et sœur Honorine Porcher (1886, 1891), sœur Anne Guesdon et sœur Maria Blondel, adjointe (1896, 1901).
Les effectifs étaient de 45 élèves en 1888, 47 en 1889, 56 en 1890, 40 en 1891, 42 en 1892, 45 en 1893, 47 en 1894, 45 en 1895, 45 en 1896, et 44 en 1897.
Longtemps à l’abandon, cette ancienne école a été transformée en maison d’habitation en 2014.
Eglise Saint-Aubin. C’est probablement dans la seconde moitié du 11e siècle que fut édifiée notre église. En 1087, on signale un certain Langulsus, curé de Loigné, qui fut témoin de la fondation du prieuré de Quelaines. Elle est dédiée à saint Aubin qui fut évêque d’Angers de 529 à 550 malgré son gré.
Sévère et zélé, il s’éleva contre les mariages incestueux et consanguins. On lui attribuait plusieurs miracles et on l’invoquait pour les maladies d’enfants. Saint Aubin est devenu le patron des boulangers et des pâtissiers. 83 communes et 110 églises françaises portent son nom.
L’édifice forme un long rectangle auquel s’appuie, au nord, une tour carrée romane, flanquée de contreforts. Au 15e siècle, on y ajouta une chapelle au nord, des fenêtres flamboyantes au sud, et les contreforts de la façade. On remarquera également les traces de deux anciennes portes percées à la même époque. Au dessus de l’une d’elles, on peut voir le reste d’un blason qui fut mutilé pendant la Révolution. L’une de ces portes servait aux femmes, l’autre aux hommes. La petite porte, située au sud, fut percée en 1711. La porte principale, qui n’a rien de remarquable, fut reconstruite en 1843 ainsi que la petite sacristie, abattue ces dernières années.
Jadis s’appuyaient sur la nef un chapitereau (avancée de bois) où se tenaient, avant 1789, les réunions paroissiales pour la nomination des syndics et procureurs. Il fut détruit en 1874.
A l’intérieur de l’église, on peut admirer le retable du maître-autel qui fut construit en 1657 par René Trouillard, architecte de la Bazouge-de-Chémeré installé à Château-Gontier. Il abrite les statues de saint Jean-Baptiste (au milieu), saint Aubin (à droite) et saint Pierre (à gauche).
Entre 1125 et 1148, Hugues Chotard donna à l’abbaye Saint-Maurice d’Angers ce qu’il possédait dans l’église, la moitié du presbytère et tous ses revenus. Ulger (photo ci-contre), évêque d’Angers de 1125 à 1148, qui prit le contrôle d’un certain nombre de prieurés et d’églises appartenant à des clercs, confirma cette donation au chapitre de Saint-Maurice d’Angers en 1148. Ulger fut inhumé dans la cathédrale Saint-Maurice la même année. En 1896, lors de l’ouverture de son tombeau, on découvrit les restes du corps revêtu de superbes étoffes, sa crosse, sa mitre et son anneau épiscopal. Les moines de Saint-Martin d’Angers, de La Roë et de Bellebranche (Saint-Brice) bénéficiaient également de dîmes provenant de la paroisse de Loigné.
L’église et le presbytère furent incendiés par des Chouans en 1802.
Liste des curés : Langulsus (1087), Jean (1331), Hervé (1372), Gilles Vallier (1460), Michel Robin (1467), Jean Dupuy (1494), Jean Locquié (1583), René Sollier (1615, 1656), Jean Bieslin (1657-1663), Charles de Quatrebarbes (1660-1695), René Allaire (1695-1706), Pierre du Tremblier de la Varanne (1706-1725), Pierre Parpacé (1725-1742), René Parpacé (1742-1748), Mathurin Chesneau (1748-1761), Joseph Fermin (1761-1776), François Logeais (1776-1791), Louis Leseigneur de Vignancourt, curé constitutionnel (1791-1793), Ragot Marie (1800), François Logeais (1801-1803), Mathurin-Etienne Chudeau (1803-1804), Louis Labouré (1804-1807), René Bouju (1807-1842), Pierre Hesteau (1842-1856), Alphonse Homo (1856-1870), Alexis-Ferdinand-Emile Brillet (1870-1872), Alexandre Laigle (1872-1885), Eugène Baudre (1885).
Depuis le 18 mai 1997, l’église de Loigné fait partie de la paroisse Saint-Jean-Bosco du Haut-Anjou avec celles de Marigné-Peuton, Houssay, Quelaines-Saint-Gault, Simplé, Peuton, Saint-Sulpice, Laigné, Ampoigné et Chemazé. Curé : Germain Dih (depuis 2014).
Au 13e siècle on signale le prieuré et la chapelle de la Madeleine de la Vernissière (lieu disparu qui se situait entre la Bretonnerie et la Bleslinière), qui furent dotés en faveur des moines de la Roë des lieux de la Vernissière, de l’Enauderie et de Vesins (Houssay).
Elections présidentielles voir Présidentielles.
Enauderie (L’). Ce lieu est cité dans le cartulaire de l’abbaye de la Roë au 13e siècle sous le nom d’Ernaudière. Si l’orthographe du 13e siècle est exacte, s’il n’y a pas eu confusion avec Esnaudière, alors ce nom désignerait à l’origine le domaine d’un certain Arnwald ou Ernaud en français, ancien nom de baptême d’origine germanique (franc) composé de deux mots signifiant « aigle » (arn) et « gouverner » (wald). Si ce nom est une mauvaise graphie d’Esnaudière, alors dans ce cas, il désignerait le domaine d’un certain Aginwald, autre nom de baptême d’origine germanique composé de deux mots, agin, « lame », et wald, « gouverner ».
Au 13e siècle, Hamelin de la Place donna l’Ernaudière ou Enauderie au prieuré de la Madeleine de la Vernissière (voir ce nom) qui dépendait de l’abbaye de la Roë. Pendant plus de 600 ans, cette ferme ne connut qu’un seul et unique propriétaire : l’abbé de la Roë. Elle fut par la Nation, le 13 avril 1791, sur l’abbaye de la Roë pour la somme de 1 500 livres.
En 1866, le fermier de l’Enauderie était Louis Barreau, époux de Perrine Gendry, 46 ans, mariés à Peuton le 19-4-1853, et le père de deux enfants : Marie, 10 ans, et Louis Barrot, 7 ans.
En 1901, la ferme était exploitée par Louis Guérin, 58 ans, fermier-patron, Augustine Quéru, 43 ans, sa femme, mariés à Bazouges le 7-9-1873, et un domestique, Baptiste Bouhours, 17 ans.
Epau (L’). Par un caprice de l’Institut géographique national (I.G.N.), ce nom de lieu s’est transformé en Le Pau (voir ce nom). Ce nom vient de l’ancien français espal qui désignait une « réserve dans une forêt », ici le bois des Rouillères (voir ce nom) qui à l’époque féodale s’étendait jusqu’aux portes du bourg. Cette réserve de chasse devait appartenir aux seigneurs des Rouillères où se trouvait un château-fort.
Erable (L’). Domaine caractérisé par un érable. Ce mot vient du bas-latin accrabulus (7e-8e s.), issu du latin acer, « érable » et du gaulois abolo, « sorbier ».
Ce lieu fut habité depuis l’époque mérovingienne. En effet, en 1901, on a trouvé dans un champ dépendant de la ferme de l’Erable, plusieurs sarcophages en ardoise et en calcaire coquillier qui contenaient encore quelques ossements friables, un anneau, une agrafe en or « à laquelle adhérait un débris d’étoffe de laine », et des bracelets. Ces objets ont été confiés au musée archéologique de Jublains. M. Chiron du Brossay nous décrit cette découverte dans le Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne : « Un cercueil de 2 mètres de long, 55 cm de profondeur et 40 cm de largeur, formé de dalles d’ardoises, dont plusieurs brisées, contenait « un squelette incomplet, les pieds à l’est, reposant sur le côté gauche, le bras droit replié, la main touchant l’épaule ». Ces sépultures remontent à l’époque mérovingienne (6e-8e siècles).
En 1899, on signale le vieux château restauré de l’Erable. En 1733, il fut vendu par Messire François-Louis Girault, maître-maçon, fils de Guillaume Girault, maître-maçon, et de Perrine Dublineau, marié le 29 juin 1711 à Azé avec Marie Pichon. En tant que maître-maçon, il travailla pour l’église de Gennes-sur-Glaize (1711) et pour la chapelle Saint-Joseph de Château-Gontier construite grâce aux dons de son voisin Guy Buffebran de la Cotelière (voir ce nom). Il avait deux frères : Joseph Girault, marchand-tissier, marié le 1er juillet 1710 à Azé avec Marie Marsollier, et Guillaume Girault, maître-maçon, qui fit des travaux aux moulins de la Bavouze (Azé).
En 1866, l’Erable n’était pas habité car ce lieu est absent dans le recensement de cette année-là.
En 1901, l’Erable était exploité par la famille Crouillebois qui se composait ainsi : Pierre Crouillebois ou Crouilbois, 78 ans, fermier-patron, Désirée Sureau, 62 ans, sa femme, mariés à Chemazé le 19-6-1859, Eugène Crouillebois, 36 ans, leur fils, employé agricole, Pierre Crouillebois, 40 ans, fermier-patron, Marie Gilard, 32 ans, sa femme, mariés à Loigné le 4-5-1889, qui avaient deux enfants : Emile, 11 ans, et Marie, 9 ans.