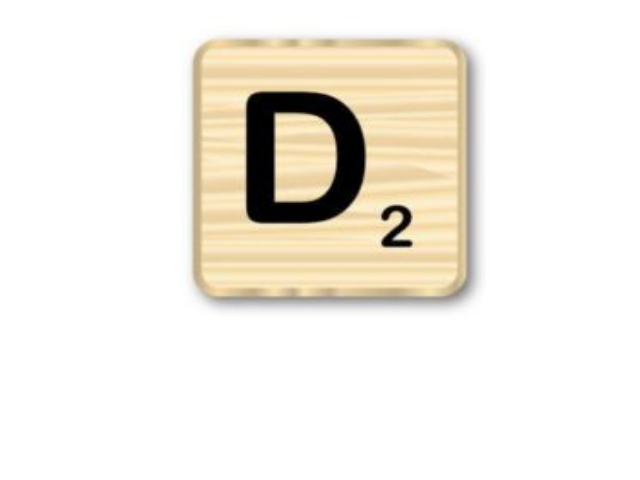
Dalibard (Baptiste). Né le 28 août 1876 à la Chaudurée de Loigné, fils de Jean-Baptiste Dalibard, cultivateur, et d’Adèle Hocdé. Soldat au 27e Régiment d’Infanterie Territoriale. Mort pour la France à l’âge de 40 ans. Mort de maladie contractée en service le 27 mars 1916 à Vadelaincourt (Meuse). Sépulture : Nécropole nationale de Vadelaincourt (Meuse), tombe 260.
Davière (La). Ce nom désigne à l’origine le domaine agricole d’un certain Davy, forme populaire de David. La ferme de David (Bouchamps-les-Craon) est citée en 1620 sous le nom de Davy.
Une famille Davy est connue à Loigné dès la fin du 16e siècle. A cette époque, on signale à Loigné le mariage, le 22 juin 1589, de Renée Davy, fille de René Davy et d’Anne de la Motte, avec Claude Simon. Les registres paroissiaux de Loigné signalent également plusieurs mariages de Davy au cours des 17e et 18e siècles :
- Marin Davy, né vers 1668, fils de Marin et de Marie Madiot, avec Renée Rebours, le 26 novembre 1693.
- Madeleine Davy, fille des précédents, avec Lancelot Brillet, le 18 septembre 1719.
- Pierre Davy, né vers 1700, fils de Jean et de Julienne Landais, avec Louise Blanchet, le 21 juin 1736.
Signalons également que Pierre Davy, contrôleur au grenier à sel de Craon et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, époux de Marguerite Le Ray, était en 1607 seigneur de la Souvetterie (ferme de Saint-Sulpice située à 2,8 km de la Davière) et qu’Anne Davy, décédée en 1667, était l’épouse d’Adam Ernault de Montiron, conseiller au Présidial de Château-Gontier, seigneur des Aulnays (voir ce nom).
En 1866, la Davière formait un hameau où vivaient cinq familles regroupant 16 personnes :
- la famille Bouillon avec le père Julien Bouillon, maçon, 46 ans, la mère Candide Régnier ou Rénier, 45 ans, mariés à Marigné-Peuton le 10-9-1849, et leurs 6 enfants : Julien, 15 ans, Joseph, 12 ans, Pierre, 10 ans, Henri, 8 ans, François, 6 ans, et Eugénie, 2 ans.
- la famille Bellay composée de Joséphine Margalet ou Margallé, veuve de François Bellay, 45 ans, mariés à Loigné le 4-11-1844, et ses deux fils, Auguste, 10 ans, et François, 21 ans.
- Jean Guérin, 62 ans, journalier, et sa femme Jeanne Bruneau, 58 ans, mariés à Houssay le 12-1-1830.
- Renée Lebrec, femme de Jean Lemonnier, 44 ans, mariés à Loigné le 28-7-1850, journalière.
- Hortense Clavreul, femme d’Alphonse Orhan, 26 ans, mariés à Bazouges le 22-6-1863, journalière. Et son fils Alphonse Orhan, âgé de 19 mois.
En 1901, le hameau de la Davière abritait 17 personnes :
- Eugène Gasnier, 38 ans, bûcheron, Marie Lebrec, 28 ans, sa femme, mariés à Loigné le 17-10-1893, leurs trois enfants : Auguste, 4 ans, Marie, 3 ans, Joseph, 1 an, et un nourrisson, Julienne Gasnier, 1 an également, probablement leur nièce.
- Henriette Pieux, 58 ans, journalière.
- Mathilde Chevreuil, 68 ans, sans-profession.
- Alphonse Orhan, 36 ans, journalier, sa femme Scholastique Jacquelin, 30 ans, leurs quatre enfants, Marie, 6 ans, Alphonsine, 5 ans, Scholastique, 3 ans, Alphonse, 2 ans, et un nourrisson, Louis Jacquelin, 1 an.
- Victor Guérin, 50 ans, bûcheron, et Adèle Tessier, sa femme, mariés à Quelaines le 17-6-1878, journalière agricole.
Depuis les années 1980-1990, le hameau de la Davière s’est vu agrandir par la construction de pavillons résidentiels qui forment de nos jours un quartier du bourg de Loigné. Certains anciens bâtiments de la Davière ont été restaurés et mis au goût du jour.
Démographie. Sous l’Ancien Régime, la population de la paroisse de Loigné était recensée en feux (familles, foyers ou ménages). Un ménage regroupait au 18e siècle 2 parents et 4 ou 5 enfants, soit 6 à 7 personnes.
1688 : 179 feux (entre 1074 et 1253 habitants) ; 1696 : 217 feux (1302 à 1519 habitants) ; 194 feux en 1700 (1164 à 1358 habitants) ; 1715 : 184 feux (1104 à 1288 habitants) ; 1732 : 190 feux (1140 à 1330 habitants). En 1779, une épidémie de dysenterie fit 144 décès.
1791 : 1001 habitants ; 1803 ; 972 habitants ; 1821 : 906 habitants ; 1831 : 906 habitants ; 1841 : 1002 habitants ; 1851 : 1036 habitants ; 1861 : 953 habitants ; 1871 : 941 habitants ; 1881 : 916 habitants ; 1891 : 858 habitants ; 1898 : 833 habitants ; 1901 : 829 habitants ; 1906 : 821 habitants ; 1911 : 804 habitants ; 1921 : 707 habitants ; 1926 : 722 habitants ; 1931 : 702 habitants ; 1936 : 691 habitants ; 1946 : 660 habitants ; 1954 : 657 habitants ; 1962 : 646 habitants ; 1968 : 576 habitants ; 1975 : 569 habitants ; 1982 : 580 habitants ; 1990 : 642 habitants ; 1999 : 704 habitants ; 2006 : 839 habitants ; 2008 : 877 habitants ; 2012 : 885 habitants.
Desmière (La). Ce lieu est indiqué au 18e siècle sur la carte de Cassini sous le nom de Dimière. Ce nom vient de l’ancien français disme/diesme, « dîme » ou domaine de Desmier/Desmé, forme méridionale de Dimier. Le desmier ou dismeur désignait au Moyen-Age celui qui était chargé de prélever la dîme (du latin decima, « dixième partie, voir la Vernissière). Cet impôt consistait dans le paiement d’une redevance en nature au clergé ou à la noblesse. Au 13e siècle, une dismerie ou desmière désignait une terre soumise à la dîme.
En 1785, René Buhigné, auditeur des comptes de Bretagne, issu d’une famille de magistrature castrogontérienne, vendit la closerie de la Desmière à Marin Hodebine, architecte et entrepreneur de bâtiments à Houssay. Ce dernier, époux de Jeanne Viot, hérita en 1786 de la closerie des Touzières située à Astillé.
En 1866, la Desmière était occupée par la famille Nobis qui se composait de Frédéric Nobis, veuf d’Henriette Chesneau, mariés à Saint-Fort le 9-9-1853, fermier, 47 ans, de ses trois enfants, Henriette, 10 ans, Frédéric, 8 ans, et Marie, 5 ans, et de Françoise Fouassier, 31 ans, domestique. Frédéric Nobis se remaria le 16-10-1866 à Loigné avec Victorine Desmazel.
En 1901, la ferme de la Desmière était habitée par la famille Moulard composée du père Joseph Moulard, patron-fermier, 28 ans, de la mère Marie Boulay, 22 ans, mariés à Loigné le 15-11-1898, et de deux enfants en bas-âge : Marie, 18 mois, et Joseph Moulard, 7 mois. Ce couple employait une domestique, Angèle Bodin, 18 ans.
Dans les années 2000, sous le mandat de Pierre Jégouic, un lotissement dit de la Desmière fut créé dans des champs appartenant à cette ancienne ferme.
Dreux (Eugène). Aucun renseignement sur « Mémoire des Hommes ». Selon des renseignements de M. Gournay de Loigné, il habitait une petite maison sur la route de Marigné-Peuton, et serait décédé d’une maladie (tuberculose). Il était rentré à Loigné avant la fin de la guerre 1939-1945.
Dupérier (Robert). Haut fonctionnaire et Résistant français, né à Souprosse (Landes), le 10 novembre 1896. En 1941, il forme avec Jacques Mitterand et une dizaine de hauts fonctionnaires le premier réseau de Résistance intérieure. En 1944, il fut nommé par le Gouvernement provisoire du général de Gaulle, préfet de la Mayenne. Il arriva clandestinement en Mayenne en mai 1944, et avec l’aide d’André Counord, chef des Résistants du pays de Château-Gontier, il s’installa dans la ferme abandonnée de la Petite-Noë (voir ce nom) de Loigné. Il était chargé de constitué en Mayenne un nouveau CDL (Comité de Libération). Etabli dans cette ferme abandonnée, il attend là le jour où, de gré ou de force, il s’installera à la Préfecture. De cette retraite où il semble vivre en parisien replié ou en vacances, il dirige les opérations, parcourant le pays en bicyclette. Il a personnellement et soigneusement caché dans un arbre creux, la boîte de cigarettes anglaises contenant son arrêté de nomination, signé du Représentant qualifié du Gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle, ainsi que les documents secrets qui lui ont été confiés, les directives du Gouvernement provisoire de la République : quelques pages dactylographiées sur papier pelure… (Marc Vallée, Cinq années de vie et de guerre en pays mayennais).
Adolphe Bouvet, facteur et résistant de Saint-Sulpice, fut son agent de liaison avec le futur comité de Libération et les divers organismes de Résistance.
Le 5 juin 1944, Robert Dupérier quittait définitivement la Petite-Noë pour se rendre, toujours à bicyclette, à Laval. Là, il fut reçut par le docteur Mer, futur président du CDL qui l’hébergea dans la clinique Saint-François, ancienne clinique du docteur Le Basser, membre du premier CDL démantelé par les Allemands, alors déporté en Allemagne. Le 6 juin, jour de la Libération de Laval, Vers 19 heures, en compagnie du docteur Mer, il prenait place à la Préfecture et destituait, sans aucune opposition, l’ancien préfet, M. Vabre, nommé par le gouvernement de Vichy. Le 7 juin, M. Robert Dupérier et le nouveau CDL tenaient sa première réunion officielle.
M. Robert Dupérier devint par la suite préfet de la Drôme en 1947, conseiller municipal de Saint-Cloud, et médaillé de la Résistance.
Dupuy (Jean). Curé de Loigné en 1494. Il précède Jean Locquié.