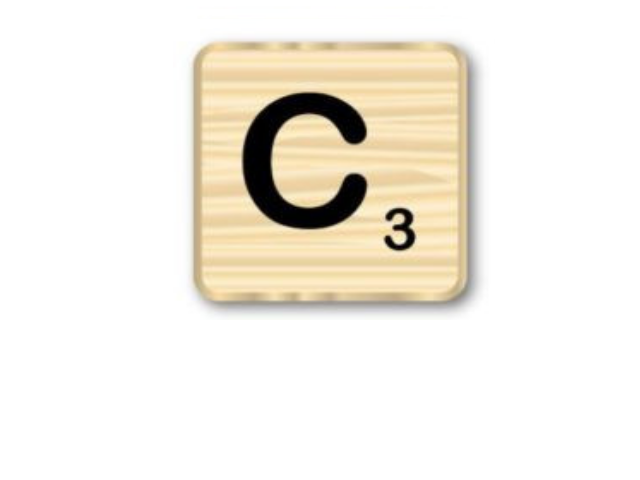
Cadeurie (La). Aussi appelée Cadurie. Ce nom semble provenir du latin caldus/calidus (chaud, qui présente une température élevée), allusion possible soit à d’anciennes forges ou à un terrible incendie (voir les Morillands).
Selon A. Pommerais (Un rempart régional, p. 51), on y a découvert des boules de terre cuite ou durcie qui peuvent être d’âge préhistorique ou d’époque romaine. A proximité, notamment à la Petite-Frézelière, on a découvert des scories de forges.
Entre 5 000-3 000 av. J.C. des hommes du Néolithique édifièrent le dolmen de la Cadeurie aussi appelé dolmen de la Pêcherie sur ce plateau dit des Morillands. Cette construction, autrefois plus importante était recouverte d’un amas de terre et de pierres (tumulus) et abritait des sépultures collectives. D’après l’archéologue Alain Valais, « cet ensemble occupait le chœur d’un monument beaucoup plus vaste, une sorte de petite colline artificielle, dont les matériaux ont été récupérés sans doute pour construire les fermes environnantes ».
Ce dolmen est également connu sous le nom de Pierre branlante car, selon la tradition, il serait possible de faire bouger la lourde table d’une simple pression. On dit que les jeunes filles qui voulaient se marier dans l’année devaient faire bouger ce colosse de pierre d’une seule poussée.
La table mesure 3,80 m de long et 2,80 m à 3 m de large. Elle ne repose plus que sur un pied formé d’un gros bloc carré d’1,40 m de côté.
En 1739, la ferme de la Basse-Cadeurie fut vendue par le seigneur de Magnannes (Ménil) à Charlotte Reillon, veuve de Pierre Guermon. En 1782, elle revint aux héritiers de Charlotte Guermon.
En 1846, la closerie de la Basse-Cadeurie était habitée par Jean Picard, 55 ans, Françoise Durand, 60 ans, sa femme, mariés à Marigné-Peuton le 20-6-1812, Rosalie Picard, 25 ans, et Françoise Picard, 28 ans, leurs filles.
La Haute-Cadurie était occupée par Jean Bodin, 70 ans, laboureur, Renée Hivert, 70 ans, sa femme, mariés le 9-1-1799 à Laigné, Victor Bodin, 28 ans, leur fils, et Flavie Houssin, 15 ans, domestique.
En 1901 la ferme de la Cadeurie était exploitée par Alexis Fournier, 63 ans, Marie Cournay, 46 ans, sa femme et Joseph Jouin, 18 ans, domestique.
En bordure du petit chemin qui redescend sur le chemin de halage, on peut voir une vielle tombe remontant à 1891 (voir photo ci-contre). Elle porte le nom de Charles Boisramé, époux de Marie Chartrain. Charles-Etienne Boisramé naquit à Grez-en-Bouère le 21 décembre 1844. En 1880, il était domestique cultivateur à la Jouannière d’Azé ou il connut Marie, Jeanne Chartrain, également domestique cultivatrice. Ces derniers se marièrent à Azé le 8 novembre 1880. J’ignore pourquoi il fut enterré en ce lieu car il n’est pas décédé sur la commune de Loigné.
Carrière (La). Le recensement de 1866 signale le lieu de la Carrière où se trouvait une petite maison d’ouvriers occupée par Prosper Join, 39 ans, carrier, Marie Brochard, 29 ans, sa femme, et Auguste Join, 16 mois, leur fils.
L’instituteur Célestin Mautaint signale, en 1899, qu’on trouve, sur tout le territoire de Loigné de nombreuses carrières, exploitées seulement pour les besoins de la localité, et par conséquent sans grande importance. Il cite des carrières de sable rouge avec graviers de quartz dans toute la partie ouest, des carrières de sables alluvionnaires dans la partie est, et de nombreuses carrières de pierre au sud et à l’est. Aucune, nous dit-il, n’est sérieusement exploitée.
Cette Carrière était située entre Vaufaron et Marmouillé.
Censies (Les). Autres orthographes : Sancies, Sencies. De l’ancien français (11e-13e s.) censer, « donner à cens (fermage), affermer ». A l’époque féodale, une censie désignait tout simplement une ferme.
Au 18e siècle, les Censies étaient divisées en deux fermes, la Grande et la Petite Censie.
En 1743, René Trioche, bourgeois d’Angers, hérita des Censies de Daniel Trioche, sieur de Montroux.
En 1781, Pierre Trioche, sieur du Bois-Pineau, vendait le domaine à N. François, de Bazouges. En 1782, la Petite-Censie fut acquise des héritiers de Charlotte Guermond par François de la Bruère (voir Marmouillé).
En 1866, les Sencies étaient occupées par François Journeault, fermier, 36 ans, Rose Péret, sa femme, 35 ans, mariés à Loigné le 23-11-1852, Marie Journeault, leur fille, 10 ans, François Journeault, veuf, grand-père, 67 ans, Félix Rimbert, domestique, 21 ans, et Clémentine Ricot, domestique, 18 ans.
En 1901, on signale la (et non plus les) Sencie occupée par Désirée-Julie Planchard, veuve de François Journeault, 58 ans, mariés à Loigné le 23-5-1871, François-Jules Journeault, domestique, son fils, 24 ans, Marie-Louise Houssin, sa femme, 25 ans, mariés à Loigné le 24-4-1900, et François Journeault, âgé d’1 jour lors du recensement.
Chalumeau (Famille). Vieille famille de paysans connue à Loigné depuis le 17e siècle. Parmi les mariages Chalumeau à Loigné, nous avons relevé ceux de :
- René Chalumeau, né vers 1657, veuf de Jacquine Planchenault, marié le 23-10-1688 à Loigné avec Renée Foucqué.
- René Chalumeau, né vers 1663, fils de René et de Françoise Guinoiseau, marié à Loigné le 25-2-1691 avec Louise Clavreul.
- René Chalumeau, veuf de Marie Foucher, marié à Loigné le 22-1-1699 avec Jeanne Bioche.
- Jean Chalumeau, né vers 1672, fils de Pierre et de Perrine Lemonnier, marié à Loigné le 4-7-1699 avec Jeanne Leconte.
- Nicolas Chalumeau, fils de René et de Françoise Guinoiseau, marié à Loigné le 19-2-1703 avec Gabrielle Fouassier, remarié à Loigné le 12-9-1709 avec Perrine Thoreau.
- Pierre Chalumeau, fils de Pierre et de Renée Martineau, marié à Loigné le 7-7-1704 avec Marie Planchenault, veuve de François Plantais.
- Nicolas Chalumeau, né vers 1716, fils de Nicolas et de Perrine Thoreau, marié à Loigné 25-6-1743 avec Perrine Véron, remarié à Loigné le 27-6-1746 avec Jeanne Potier.
- Charles Chalumeau, né vers 1716, fils de Pierre et de Marie Planchenault, marié à Loigné le 15-9-1746 avec Mathurine Legaigneux ou Gagneux.
- Nicolas Chalumeau, fils de Nicolas et de Jeanne Potier, marié à Loigné le 25-6-1776 avec Perrine Chevreul.
- Pierre Chalumeau, né vers 1757, fils de Nicolas et de Jeanne Potier, marié à Loigné le 15-6-1779 avec Perrine Bobard.
- Charles Chalumeau, né vers 1760, fils de Charles et de Mathurine Gagneux, marié à Loigné le 19-7-1800 avec Perrine Lalloyer.
- Pierre Chalumeau, né en 1787 à Bazouges, fils de Pierre et de Louise Chalumeau, veuf de Renée Viot, marié à Loigné le 9-6-1826 avec Angélique Lalloyer.
- Ferdinand-Louis Chalumeau, né en 1817 à Château-Gontier, fils de Claude-Victor et de Marie-Perrine Godereau, marié à Loigné le 5-2-1844 avec Marie Dubois.
- Pierre-Romain Chalumeau, né en 1839 à Ampoigné, fils de Jacques et de Lucie Sollier, marié à Loigné le 9-11-1868 avec Aimée-Louise Ciron.
Chambrisé. Ferme disparue de nos jours. Elle était située à proximité de la Pommeraie et apparaissait sur le plan cadastral de 1833 sous le nom de Champ-brisé. Ce nom désigne à l’origine un champ dévasté, ravagé, détruit.
En 1782, Chambrisé appartenait à Marie Thoumin, Charles Arthuis, avocat, qui épousa, le 13 novembre 1731, Catherine Thoumin, fille de François Thoumin et de Catherine Boucault, Catherine Arthuis, fille de Charles Arthuis et de Catherine Thoumin, qui épousa Louis d’Héliand à Château-Gontier le 30 avril 1764, et Pierre Arthuis, héritier de Françoise Thoumin.
En 1802, la ferme revint aux consorts (cohéritiers) Guénard.
En 1856, Champ-Brisé était habité par Louis Pécot, 42 ans, cantonnier, et sa femme Renée Chevreul, 42 ans, mariés à Loigné le 17-11-1850.
En 1866, Champ-Brisé était occupé par Auguste Poirier, fermier, âgé de 53 ans.
En 1901, ce lieu n’existait déjà plus.
Changion (Jean). Nommé maire de Loigné en 1791. Les élections prévues pour le 20 novembre ne purent avoir lieu pour défaut de serment ce qui provoqua des émeutes. Elles furent remises au 5 décembre sous la présidence de deux membres du Directoire, MM François et Pichard.
Chantemesle. Du latin canta merula, « chante merle ». Désigne à l’origine un lieu fréquenté par les merles probablement attirés ici par des arbres fruitiers. En Normandie et dans le Bas-Maine, on employait le mot mesle pour désigner le merle. Ce nom est à apparenter aux Chantepie, Chantoiseau, Chanteloup. Chantemesle de Beaumont-Pied-de-Bœuf est cité sous le nom de Cantusmerule en 1010.
La maison de maître actuelle semble, par son architecture, remonter à la fin du 17e siècle au du début du 18e siècle. Elle attenait à une ferme connue sous le nom de Petit-Chantemesle. La ferme a disparue et le logis a été restauré avec goût par M. et Mme Cribier, les actuels occupants.
Dans la seconde partie du 18e siècle, Chantemesle appartenait à la famille Richard de la Guyonnière dont Michel-Pierre Richard de la Guyonnière, époux d’Anne Blanchet, président au grenier à sel de Château-Gontier entre 1766 et 1773, et Michel-Pierre-Charles Richard de la Guyonnière, époux de Françoise Cherbonnier, également président au grenier à sel en 1787.
A cette famille appartenait Ursule-Elisabeth Richard de la Guyonnière, épouse de Charles-Louis Trochon de la Davière (domaine agricole situé à proximité de Chantemesle), mère de Marie-Mélanie Trochon de la Davière (1803-1832).
En 1866, le logis du Grand-Chantemesle était occupé par Louis Nobis, fermier, 42 ans, Anne Herrouet, sa femme, 38 ans, mariés à Ampoigné le 28-1-1850, et Louis Nobis, fils, 15 ans.
Le Petit-Chantemesle était occupé par François Besnier, fermier, 44 ans, et Françoise Legeard, 35 ans, mariés à Loigné le 29-11-1854, qui élevaient trois nourrissons : Marie, 5 ans, Louis, 4 ans, et Pierre Jacquelin, 1 an.
En 1901, Chantemesle était habité par Pierre Colibeau, fermier, 32 ans, Adélaïde Lorée, 29 ans, sa belle-sœur, domestique, et Marie Lorée, 52 ans, sa belle-mère. Pierre Colibeau épousera Adélaïde Lorée le 15 juin 1903 à Houssay.
Chardon (Emmanuel). Né le 14-avril 1834 à Châtelain, fils de Mathurin Chardon et de Jeanne Lefèvre, domiciliés à Loigné. Soldat au 5e Régiment de Dragons, 5e Escadron, décédé le 22 juin 1855 à l’hôpital civil de Limoges (Haute-Vienne) suite d’une pneumonie.
Chardonnière (La). Il existe deux explications concernant l’origine de ce nom. Il peut désigner le domaine agricole d’un certain Chardon. Ce nom de famille se retrouve dans les registres paroissiaux de Loigné dès le 18e siècle avec le mariage de Jacques Chardon, né en 1740, fils de Pierre Chardon et de Jeanne Guilay, qui épousa, le 7 février 1764 à Loigné, Perrine Chevreul, âgée de 27 ans, fille de René et d’Anne Vivier. Il peut également désigner un lieu couvert de chardons. Les feuilles piquantes de cette plante du genre carduus servait autrefois à carder la laine ou le lin.
La ferme de la Chardonnière, qui de nos jours tombe en ruines, appartenait en 1561 à Claude d’Ecuillé et relevait du fief (domaine féodal) de la Rouillère où se trouvait un château.
En 1659, la Chardonnière appartenait à Jacques Deniau, sieur de Vaugeois, garde-scel à Château-Gontier, fils de Jean Deniau, sieur du Verger.
En 1786, on signale la Chardonnière-des-Monceaux qui appartenait à François Loré, avocat à Château-Gontier.
En 1866, on y trouve Pierre Doreau, fermier, 56 ans, Jeanne Després, 61 ans, sa femme, Jules, 22 ans, et Perrine, 24 ans, leurs enfants.
En 1901, la Chardonnière était habitée et exploitée par la famille Meslin composée de René Meslin, 59 ans, fermier-patron, Eugénie Bodin, 57 ans, sa femme, mariés à Loigné le 14-1-1873, Marie Meslin, 25 ans, leur fille, employée agricole, et Eugène Meslin, 18 ans, employé agricole. Joséphine Brault, 78 ans, vivait également en ce lieu.
Le calvaire de cette ancienne ferme a été récemment restauré par l’Arcem (Association pour la restauration des croix et calvaires en Mayenne). Sur les 6 400 calvaires répertoriés en Mayenne, cette association en a restauré 239 dans 101 communes mayennaises.
Chardonnière-Frézeau (La). Pour la différencier de son homonyme, on ajouta le nom de Frézeau à ce nom de lieu en souvenir de ses anciens possesseurs, les seigneurs de la Frézelière (coir ce nom).
Au début du 18e siècle, la métairie de la Chardonnière-Frézeau appartenait à Antoine Aubert, avocat à Château-Gontier, qui la légua, à sa mort, à son frère Nicolas Aubert, chanoine de Saint-Just de Château-Gontier. Les héritiers de celui-ci vendirent la métairie de la Chardonnière et de la Grée (Saint-Fort), en 1758, à Pierre Tafforeau, sieur de la Gonneraie.
La carte de Cassini, qui date du début du 18e siècle, signale en ce lieu la présence d’un château qui a laissé place de nos jours à une élégante maison de maître. Dans la première moitié du 20e siècle, les sœurs Augustines de Saint-Joseph et de l’hôpital de Château-Gontier y établirent un centre de vacances pour les jeunes orphelines et filles pauvres du pays de Château-Gontier. Elles firent alors construire à côté de la maison de maître, qui leur servait de logements, un long dortoir sur préau sous lequel elles établirent une petite chapelle dont il ne
reste que quelques traces de décors. Les sœurs dressèrent aussi, à l’entrée du chemin menant à ce lieu, un joli calvaire que l’on peut encore voir de nos jours. Deux photos, prises dans les années 1920-1930, montrent une classe de vacances et le calvaire (voir photos ci-contre et ci-dessus).
En 1866, le « château » de la Chardonnière-Frézeau, en l’absence des propriétaires, était gardé et habité par Etiennette Guard, domestique, 48 ans. La ferme, quant à elle, était occupée par Louis Crouillebois, métayer, 48 ans, Claudine Boulay, 38 ans, sa femme, mariés le 18-11-1860 à Loigné, et Louis Crouillebois, fils, âgé de 4 ans. Edouard Maussion, 23 ans, qui vivait avec eux, exerçait alors la profession de domestique de ferme.
En 1901, la ferme de la Chardonnière-Frézeau était exploitée par la famille Nail avec Auguste Nail, 54 ans, fermier-patron, Marie Touiller, 39 ans, sa femme, mariés à Gennes-sur-Glaize le 24-4-1882, Marie, 14 ans, Clémentine, 11 ans, Auguste, 7 ans, et Lucienne, 2 ans, leurs enfants. Jules Gerbouin, 19 ans, était employé comme domestique de ferme.
Le mercredi 17 mars 2010, un terrible incendie ravageait les combles de la maison de maître.
Chauduré. Aussi appelé la Chaudurée, Chauduray ou la Chaudurais. Du latin calidus, « chaud ». Ce nom conserve le souvenir d’anciennes forges (voir la Cadeurie), ou de fonderies (voir Lorfeuille). La proximité du lieu-dit les Loges (anciennes cabanes de bûcherons ou de charbonnier) laisserait aussi supposer un lieu ou l’on fabriquait du charbon de bois. Celui-ci s’obtenait en empilant du bois en un tas recouvert d’une couche d’argile, que
l’on enflammait. Une partie du bois étant consumée en consommant tout l’oxygène, la chaleur produite transformant le reste du bois en charbon. La carbonisation était réalisée par des charbonniers directement en forêt, au plus près de la ressource de bois.
L’abbé Angot signale parmi les bénéfices anciens de l’église de Loigné, la chapelle de la Chauduré ou Chauduray dont furent pourvus Elie de Quatrebarbes (1662), Claude de Quatrebarbes et Jacques de Quatrebarbes (1667).
En 1866, la ferme de la Chauduray était exploitée par Pierre Monnoury, métayer, 40 ans, et sa femme, Marie Ayet, 39 ans. Ce couple employait trois domestiques : Pierre Chauset, 32 ans, François Boursier, 32 ans, et Olympe Turpin, 25 ans, sa femme.
En 1901, la Chaudurée était tenue par Adèle Hocdé, veuve de Jean-Baptiste Dalibard, mariés le 22-11-1875 à Ruillé-Froid-Fonds, fermière-patronne, 52 ans, Baptiste Dalibard, 24 ans, son fils, employé agricole, et Adèle Dalibard, 20 ans, sa fille.
Chelluère (La). Ce nom est aussi orthographié Chéluère. Désigne le domaine agricole d’un certain Chelu. Ce nom de famille est très rare et son origine géographique reste difficile à situer. On le trouve en Mayenne en 1613 du côté de Saint-Pierre-la-Cour et au 18e siècle dans les Yvelines et les Ardennes. Ce nom est peut être un dérivé de l’ancien français chael, « possession, bien, profit ».
Dans la première moitié du 18e siècle, la closerie de la Chelluère appartenait à la famille Bernier. Au décès de Pierre Bernier, en 1741, elle revint à Jean Paigis, marchand tanneur à Azé, qui avait épousé Perrine Chanteau à Château-Gontier le 21 avril 1705.
En 1866, la Chelluère était exploitée par Pierre Pellier, 35 ans, et Marie Mingot, 33 ans. Ce couple élevait leurs trois enfants : Pierre Pellier, 2 ans, Victor Denis, 9 ans, fils de l’épouse, et Augustine Denis, 5 ans, fille de l’épouse. Il employait un domestique agricole : François Oger, 17 ans.
En 1901, la Chéluère était occupée par Emile Aubry, 44 ans, fermier-patron, Augustine Denis, citée ci-dessus, 40 ans, sa femme, mariés à Peuton le 23-11-1881, Augustine Aubry, 17 ans, employée agricole, leur fille, et Marie Mignot, 69 ans, domestique de ferme.
Chesneau (Mathieu). Curé de Loigné de 1748 à 1761. Il succéda à René Parpacé et précéda Joseph Fermin. Il décéda le 24 avril 1761 à l’âge d’environ 48 ans et fut inhumé dans le cimetière de Loigné le 25 avril en présence de Pierre Chesneau, son frère, de la paroisse Saint-Maurice d’Angers, de Marthe Chesneau, sa sœur, maîtresse des pensionnaires de la Communauté de la Croix d’Angers, et de Marie-Anne Chesneau, sa nièce.
Chevalerie (La). Désigne à l’origine le domaine agricole d’un certain Chevalier. Une famille Chevalier était établie à Loigné dès le 17e siècle. Michel Chevalier, époux d’Anne Bouvet, eut un fils, né vers 1664, qui épousa à Loigné, le 14 février 1684, Martine Lacrais, âgée de 37 ans, veuve de Charles Bodelle. On retrouve le nom de cette famille Chevalier dans des actes paroissiaux de 1751 et 1765, ainsi que dans le registre d’état-civil de 1834.
L’ancienne ferme de la Chevalerie était située sur l’ancien chemin de Loigné à Bazouges, chemin qui débouchait à l’actuelle Féerie, route de Marigné. Abandonnée puis détruite après 1846, elle fut reconstruite en bordure de la route stratégique construite après 1834 (actuelle route de Château-Gontier).
Le 7 nivôse an III (27 décembre 1794), le fermier de la Chevalerie, François Raffray, fut pris par les Chouans, massacré à coups de sabre, et jeté dans l’étang des Monceaux.
Voici textuellement ce qui est écrit dans le registre paroissial à cette date : « Aujourd’hui sept nivose an troisième de la République, une et indivisible, devant nous Justin Gailliard, officier Public nommé par la commune de Loigné, soussigné, ont comparu les citoyens Jean Béton journalier, âgé de cinquante neuf ans, demeurant aux village du Bas-Ronceray en cette commune, et Jean Ballend, closier âgé de quarante cinq ans, demeurant à la Turmalière aussi de cette commune, et lesquels nous ont déclaré que François Raffray, laboureur âgé de soixsante deux ans, demeurant à la Chevallerie, en cette commune, a été pries, et masacré, et jeté dans létant des Monceau par les mains des brigants, et nous y étant transportés, ayons vu le cadavre du dit François Raffray, mors, et masacré, à coups de sabre, et nous ont lesdits Jean Béton et Jean Ballend, déclaré que ledit François Raffray est déçédé, de tout quoi avons dressé le présent acte, fait et arrêté en la salle publique de la maison commune dudit Loigné, lesdits jour et an en présence desdits Jean Béton, et Jean Ballend, qui ont déclaré ne savoir signé de le enquis d’hier sur les trois heures du matin, Gailliard, officier public ».
L’ancienne ferme de la Chevalerie n’existait plus en 1866 car elle n’apparaît pas dans le recensement de la population de cette année là. Cependant, elle était toujours présente en 1846, année où elle était habitée par Augustin Fouassier, 29 ans, laboureur, Victoire Brault, 20 ans, sa femme, mariés à Laigné le 12-10-1845, François Robineau, 20 ans, domestique, Marie David, 18 ans, domestique, Augustin Fouassier père, 64 ans, et Henriette Hirbec, 49 ans, sa femme, mariés à Ruillé-Froid-Font le 27-11-1815.
La nouvelle ferme de la Chevalerie, aussi appelée le Pavillon en 1899, était exploitée en 1901 par Léon Perrier, fermier-patron, 52 ans, et son épouse, Marie Laizi, 46 ans.
Chevrollier (Julien). Né à Chemazé le 4 novembre 1800, fils de Louis et de Pélagie Duray. Célibataire, propriétaire cultivateur. Maire de Loigné de 1854 à 1871. En mai 1856, il fut en conflit avec le curé René Bouju. En octobre 1870, la sous-préfecture dit de lui qu’il ne « fait pas de politique ». Il décéda au bourg de Loigné le 6 décembre 1881. On lui doit la construction d’un mur et d’un portail en fer au cimetière.
Chouannerie. Mouvement insurrectionnel des paysans de l’Ouest pendant la période révolutionnaire. Elle doit son nom à Jean Cottereau dit Jean Chouan, l’un des premiers insurgés de la Mayenne. Les principales causes de cette insurrection sont la levée en masse de jeunes hommes par tirage au sort pour aller faire la guerre et défendre les frontières de la Patrie (1792, 1793) et enlever des bras aux travaux de la campagne, la persécution des curés qui n’avaient pas prêté serment à la Constitution et leur remplacement par des curés laïcs constitutionnels, et l’exécution de la famille royale. Contrairement aux Vendéens, autres insurgés d’Anjou et de Vendée en 1793 qui avaient une véritable armée commandée par des généraux nobles et qui n’hésitaient pas à mener des batailles de front, les Chouans appliquèrent la guérilla. En petits groupes, ils participaient à des embuscades, attaquaient les convois républicains venus faire des réquisitions dans nos campagnes, chassaient les curés constitutionnels et les officiers municipaux et punissaient de morts les paysans « collaborateurs » qui vendaient denrées et fourrage aux troupes républicaines établies dans les villes.
Il n’y eut pas une, mais plusieurs chouanneries : la première et la seconde vont du mois d’août 1792 au mois de mars 1796, la troisième va de la pacification de 1796 à la guerre des mécontents de 1799, la quatrième eut lieu entre 1800 et 1804, la cinquième appelée la petite chouannerie se déroula en 1815 et la sixième, celle de 1832, fut fomentée par la duchesse de Berry. C’est après cette dernière chouannerie (en 1834) que fut construite la « route stratégique » (ligne droite sans haies ni arbres) de Château-Gontier à Laval par Loigné et Quelaines. Avant cette construction, on devait emprunter un chemin de terre et de pierre, peu carrossable l’hiver, qui passait derrière les fermes de la Pommeraie et des Aulnays pour arriver dans le bourg au niveau de la Féerie. De là, pour aller à Quelaines, on devait emprunter l’actuelle rue des Vignes puis passer à la Desmière, puis derrière la Martelière et rejoindre la Tuilerie.
Les Chouans du pays de Château-Gontier obéissaient aux ordres de deux chefs : Jean-Louis Treton dit Jambe d’Argent, de Quelaines, et Joseph-Juste Coquereau, de Daon. Les chouans avaient adoptés des surnoms de guerre (Sabre-Tout, Cœur-de-Roi, Jambe-d’Argent…). Celui de Loigné avait reçu le surnom de la Fiole sans doute à cause de son penchant pour l’alcool. C’est lui qui égorgea à Loigné le capitaine de la garde nationale, François Moreul (8 janvier 1796). « La Chouannerie terminée », nous dit Célestin Mautaint, instituteur à Loigné de 1896 à 1908, la Fiole « reparut dans le pays, mendiant de ferme en ferme, faisant l’idiot et la sourde oreille si on lui parlait des Chouans ».
L’histoire de Loigné est parsemée de faits divers concernant cette période trouble de la Révolution française.
En 1793, le bourg fut traversé par les Vendéens. A leur passage, Perrine Ferré, femme de François Bodinier, incita le