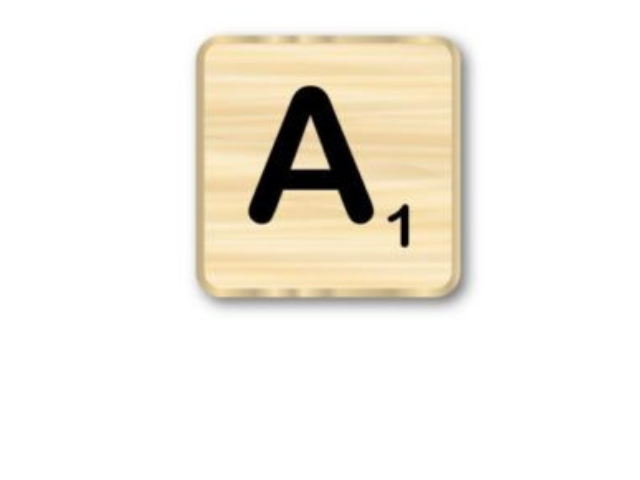
Aubrière (L’). De nos jours Laubrière. Ce nom provient du nom de famille Aubry augmenté du suffixe -ière. A l’origine, il désigne le domaine agricole d’un certain Aubry, forme populaire du nom de baptême Albéric, nom d’origine germanique (franc) composé de deux mots : alb- (sens obscur) et ric (« puissant »).
Signalons qu’une famille Aubry possédait Bénissons et la Grande-Pommeraie de Loigné au 18e siècle et que le nom Aubry est mentionné dans les actes paroissiaux dès 1664 en la personne de Marin Aubry qui fut inhumé dans le cimetière de Loigné le 20 avril. Dans ces registres paroissiaux, nous trouvons également le mariage de Renée Aubry, née en 1678, avec Mathurin Gigon le 25 janvier 1718. Celle-ci était la fille de René Aubry et de Françoise Girard qui demeuraient en la paroisse de Houssay.
Cette ancienne longère est située à la sortie du bourg, route de Marigné-Peuton. Elle fut construite après 1834.
Aulnays (Les). Ce nom vient du latin alnetum, mot formé à partir du latin alnus (« aulne ») et du suffixe collectif -etum. Ce nom désigne à l’origine un lieu planté d’aulnes.
Cette ferme appartenait au 18e siècle à Adam Ernault de Montiron, conseiller au Présidial de Château-Gontier, époux de Louise Pinard, demeurant à Angers, qui à sa mort en 1752 laissa le domaine agricole des Aulnays à Louis-Pierre Ernault de Montiron, mari d’Adélaïde de Bonchamp. Au décès de ce dernier, le 16 août 1802, succédèrent ses nièces Charlotte et Louise Collas de l’Eperonnière, issues du mariage de Louise-Claude Ernault et de Charles-François Collas, seigneur de l’Eperonnière de Livré-la-Touche.
Louis-Pierre Ernault de Montiron était également seigneur de Noirieux en Saint-Laurent-des-Mortiers, château qu’il fit construire en 1747. La famille Ernault de Montiron, famille de magistrature, possédait aussi deux hôtels particuliers situés à Château-Gontier, l’un au n° 17 de la rue Jean-Sylvain-Fouassier, l’autre au n°3 de la rue du Riochet.
En 1866, on y trouve deux familles, les Royer et les Chapelle :
- Pierre Royer, métayer, 32 ans, Adélaïde Drugeot, 25 ans, sa femme, mariés le 26-11-1865, à Astillé, Théodore Besnier, 42 ans, domestique, Julien Bergeot, 33 ans, domestique.
- Jean Chapelle, métayer, 65 ans, Catherine Houtin, 56 ans, sa femme, Jean Chapelle, 30 ans, leur fils, Marie Chapelle, 24 ans, leur fille, Jean Morin, 59 ans, pensionnaire, et René Raimbault, 33 ans, domestique.
En 1901, les Aulnays étaient occupés par les familles Royer et Bodin : Pierre Royer, 67 ans, sans profession, Joseph Royer, 28 ans, patron-fermier, Marie Mayer, 25 ans, sa femme, Joseph Bodin, 15 ans, domestique Royer, Louis Bodin, 23 ans, domestique Royer, Louise Royer, 26 ans, sa femme, domestique Royer, Pierre Royer, 34 ans, patron fermier, Marie Guérin, 26 ans, sa femme, Pierre Royer, 3 ans, leur fils, Joseph Royer, 1 an, leur fils, et Auguste Gohier, 26 ans, domestique Royer.
(Photo ci-dessus : plan cadastral de 1833).
Aupin (L’). Contraction d’Aubépin. Cette ferme est citée dans le cartulaire de l’abbaye de La Roë en 1668 sous le nom de l’Aubépin. Ce nom désigne à l’origine une terre où poussait de l’aubépine (du latin alba spina, « épine blanche »). Dans le patois mayennais, l’épine blanche était également connue sous le nom d’aupoupin.
En 1866, Laupin était occupée par François Ferré, fermier, 35 ans, Marie Cousin, 44 ans, sa femme, François Ferré, 3 ans, leur fils, Jean Cousin, veuf, 70 ans.
En 1896, la ferme de l’Aupin était tenue par la famille Mottais qui se composait, à cette date, d’Eugène Mottais, chef de famille, âgé de 50 ans, de Victorine Morel, 28 ans, son épouse, d’Auguste Mottais, 14 ans, et d’Eugène Mottais, 8 ans, leurs enfants.
Autheux (Le Petit et le Grand). Ce nom provient du bas-latin altarium issu du latin altare, « autel ». Il désigne à l’origine une petite église, une chapelle ou encore un autel antique païen.
Au 17e siècle, pour distinguer le Grand et le Petit Autheux, on ajouta le nom de leurs occupants : l’Autheu-Soursil (1668) et l’Autheu-Bougler (1660) où se trouvait un moulin à vent.
En 1467, René Frézeau (voir la Frézelière), propriétaire des lieux, donna le Petit-Autheux et Champagne (Bazouges) en partage à ses puînés.
En 1506, les Autheux appartenaient à Renée du Chastelier, veuve de Jean de la Durantière, et, en 1633, à René d’Héliand, époux de Marie Blanchet.
Issus d’une vieille famille de noblesse, les d’Héliand possédaient les terres paroissiales d’Ampoigné, Chantrigné, Molières, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Loup-du-Gast et les domaines d’Autheux, d’Ingrandes (Azé)…
René d’Héliand et Marie Blanchet eurent de nombreux enfants baptisés en l’église Saint-Jean de Château-Gontier : René, 1635, René, 1638, Renée, 1643, Françoise, 1645, Catherine, 1646, Anne et Françoise, 1647 et Pierre d’Héliand qui épousa à Loigné, en 1689, Marie Duchemin, veuve de René Buhigné, sieur des Barres (voir Malabry).
En 1662, les Autheux furent vendus par René d’Héliand à François Blanchet, prêtre, issu d’une famille bourgeoise de Château-Gontier. Avant 1787, le Grand-Autheux, Viaulnay et Fontenailles appartenaient au comte Toussaint-Henri Le Jumeau, ancien capitaine de cuirassiers, et à Jacques de la Rivière, époux de Louise Le Jumeau. En 1787, ils vendirent ces terres à Charles Girard de Charnacé, ancien capitaine au régiment de Maillé et seigneur du Lion-d’Angers.
Le 24 mai 1791, le Petit-Autheux, propriété des religieuses du monastère du Buron (Azé), fut vendu par la Nation à Pierre-Claude Quinefault pour la somme de 17 000 livres. Ce dernier possédait également Bénisson (voir ce nom). En 1798, le Petit-Autheux revint aux enfants de Pierre-Claude Quinefault.
En 1866, le Petit-Autheux était occupé par Jacques Lemesle, fermier, 41 ans, Marie Thuau, 40 ans, sa femme, Jacques, 13 ans, Marie, 11 ans, Louis, 7 ans, et Auguste Lemesle, 2 ans, leurs enfants, Pierre Bieslin, 21 ans, domestique, et Joséphine Joubert, 19 ans, domestique.
Cette même année, le Grand-Autheux était habité par René Turpin, 84 ans, fermier, Louis Turpin, fermier, 43 ans, Pierre Boursier, veuf, 64 ans, domestique, Flavie Houssin, femme Cousin, 34 ans, domestique, Hortense Cosson, 16 ans, domestique, Auguste Houdebine, 35 ans, domestique, Pierre Turpin, 32 ans, domestique, et Louis Chaigneau, 45 ans, domestique.
En 1901, la ferme du Petit-Autheux était exploitée par la famille Lemesle composée ainsi : Louis Lemesle, 42 ans, fermier-patron, Berthe Hacques, 36 ans, son épouse, mariés à Loigné le 20-1-1891, Louis Lemesle, 4 ans, leur fils, Alexis Hacques, 60 ans, et Clémentine Mottais, 57 ans, parents de Berthe, mariés à Loigné le 3-6-1886, Angèle Hacques, 21 ans, leur fille, qui s’occupait d’un nourrisson âgé d’un an du nom de René Crouillebois. Cette famille était aidée dans les travaux agricoles par Eugène Quittais et Jean-Baptiste Aubry, 54 ans, qui logeaient également dans cette ferme.
A la même date, le Grand-Autheux était occupé par la famille Pottier composée du père Jean Pottier, 48 ans, fermier-patron, de la mère Marie Pottier, 42 ans, et de deux enfants, Joséphine et Henri. A cette famille, il faut ajouter les deux domestiques : Henri Trémulot, 16 ans, et Jules Chalumeau, 11 ans. Sachez qu’en 1900, un domestique âgé de moins de 18 ans se faisait, en moyenne, un salaire de 200 à 250 francs. Les filles de moins de 18 ans étaient moins payées puisqu’elles ne touchaient qu’entre 100 et 150 francs par an.
C’est au Grand-Autheux que naquit Henri Pottier (voir ce nom), l’un des deux centenaires de la commune de Loigné.
Aviré (Le Bas et le Haut). Aviriacus ou Aviriacum, devenu en français Aviré, désignait à l’origine le domaine agricole d’Avirius, nom d’homme latin. Cette étymologie se retrouve dans le nom de la commune angevine Aviré et dans celui du lieu-dit Aviré en Azé.
Le Haut et le Bas Aviré de Loigné formaient au 15e siècle un seul et unique domaine qui avait justice foncière et était vassal de la seigneurie de Château-Gontier.
Parmi les propriétaires de ce domaine agricole, on signale Gilles Hocquedé en 1414, Pierre de Rallay en 1456, Guyonne de Rallay en 1466, qui reçut à bail la terre de son fils Jean de Rallay, Marie de Courbes en 1532, Jean-Francisque de Jouino en 1539 et Francisco Jouino entre 1545 et 1563.
En 1563, Jean Bonvoisin, mari d’Isabeau de Fleurville, acheta le domaine d’Aviré. Celui-ci décéda avant 1588, date à laquelle sa veuve épousa, en secondes noces, Jean du Coudray. Lancelot de Quatrebarbes, époux de Marie Bonvoisin, hérita en 1602. A ce dernier succéda, en 1669, René Nigleau.
Au 18e siècle, le Bas et le Haut Aviré revinrent à M. Lepelletier qui, décédé en 1756, laissa son acquisition à ses héritiers : Guillaume Lepelletier, bailli de Sablé, Gabriel Lepelletier, prieur de Saint-Loup, Joseph Lepelletier, curé de la Trinité de Laval et Marthe Lepelletier, épouse de Guillaume Gallais de la Malonnière. En 1778, Jean-Baptiste Malécot, mari de Marthe-Olive Gallais de la Malonnière, fille de Jérôme Gallais, conseiller au Présidial de Château-Gontier, hérita de la terre. Jean-Baptiste Malécot fut guillotiné à Château-Gontier pendant la Terreur.
On dit que Jean-Baptiste Malécot, marchant au supplice avec le curé Claude Gilberge, aurait tendu sa tabatière au prêtre en disant : « Allons curé, une dernière prise ? ». Jean-Baptiste Malécot habitait une grande maison de la rue du Sable (de nos jours rue Pierre-Martinet) à Château-Gontier. Sa veuve donna en viager ses propriétés à Pierre Martinet, notaire de Château-Gontier.
Entre-temps, le domaine d’Aviré avait été vendu nationalement le 24 mai 1791. La famille Pitault racheta le Bas-Aviré qui, en 1801, revint en héritage à Cécile, Louis et Renée Pitault, épouse de Julien Paigis. La famille Paigis possédait également la Chelluère de Loigné (voir ce nom).
En 1856, la ferme du Haut-Aviré était exploitée par la famille Girandier composée du père, Lucien Girandier, 29 ans, laboureur, de son épouse Françoise Boisramé, 31 ans, et de ses enfants Louis et Marie Girandier. Les Girandier employaient trois domestiques : Louis Doisbin, Louis Bruneau et Marie Péju.
A la même époque, trois familles vivaient au Bas-Aviré :
- la famille Bertron composée du père, René Bertron, laboureur, 42 ans, de Marie Lecompte, 41 ans, son épouse, mariés à Bazouges le 29-7-1838, et de René et Marie Bertron, leurs enfants. La grand-mère, Jeanne Valleray, vivait avec eux.
- la famille Beauné composée de Louis Beauné, laboureur, et de sa femme Françoise Picard. Deux domestiques vivaient dans leur ferme : Jean Bellanger et Michelle Manseau.
- la famille Planchenault composée de Pierre Planchenault, 44 ans, de Françoise Fouassier, sa femme, âgée de 34 ans, mariés le 23-4-1854 à Loigné, et de leur fille, Aimée, qui avait 2 mois à l’époque du recensement de 1856. Joseph Planchenault, Jean Ferré et Anne Poirier venaient compléter le foyer en tant que domestiques.
En 1901, le Bas-Aviré était occupé par trois familles :
- celle de Louis Chevreul, 45 ans, fermier-patron, et de Mélanie Planchenault, 43 ans, sa femme, mariés à Loigné le 28-11-1884, qui avaient 5 enfants : Louis, 15 ans, Marie, 14 ans, Alphonsine, 13 ans, Mélanie, 12 ans, et Auguste, 9 ans.
- celle de Joseph Moreau, 59 ans, fermier-patron, et de Véronique Moreau, 55 ans, son épouse, qui avaient 3 enfants : Joseph, 22 ans, Marie, 21 ans, et Angèle, 20 ans.
-et celle de René Bertron, 62 ans, époux de Désirée Régnier, 59 ans, mariés à Bazouges le 7-6-1864. Ceux-ci employaient et hébergeaient deux domestiques : Prosper Cadot, 25 ans, et Marie Pouillé, 18 ans.
Le Haut-Aviré, à cette date, était exploité par Théodore Malheri, 68 ans, fermier-patron, Victoire Paillard, 66 ans, sa femme, et Théodore Malheri, 28 ans, leur fils, employé agricole.