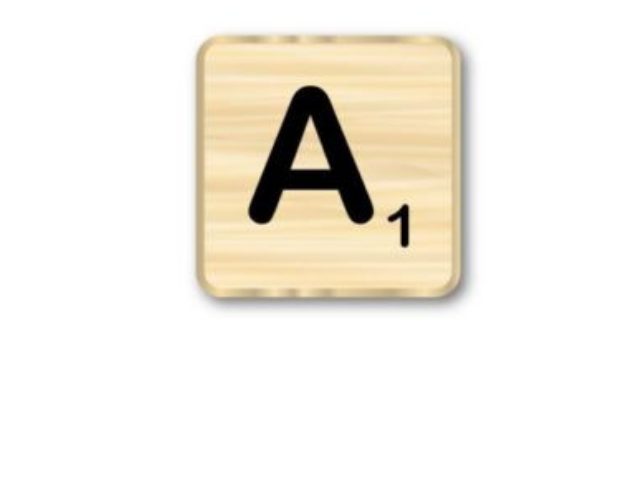
Agriculture. Selon un Mémoire de Miromesnil daté de 1696, la paroisse ecclésiastique (devenue, à la Révolution, commune avec la seigneurie paroissiale et la paroisse fiscale) avait une superficie de 1500 arpents. Un arpent est une ancienne unité de surface agraire correspondant à 100 perches soit 42,21 ares. 1500 arpents correspondaient donc à 633,15 hectares, soit environ 4 fois moins que la superficie actuelle. Ces 1500 arpents se décomposaient ainsi : 690 arpents en terre labourables (soit 291,249 hectares), 310 arpents en pâtures (130,851 hectares), 200 arpents en bois (84,42 hectares), 150 arpents en vignes (63,315 hectares), et 50 arpents en landes et terres ingrates (21,105 hectares).
Parmi les cultures au 18e siècle, on signale le froment qui, dit-on, ne valait pas mieux que le seigle, l’avoine, le blé noir, le choux, les racines et le lin. La culture de la vigne était importante dans l’Ancien Régime, on signale, aux 15e-16e siècles, les clos de la Bretonnerie, des Noes, des Roncerais, de la Desmière, de la Fortinière, de la Morinière, de Malabry, des Morillands, des Poiriers, des Monceaux et des Touches.
Les bœufs étaient principalement élevés comme bêtes de trait et les troupeaux de moutons étaient nombreux dans nos jachères et nos landes.
En 1898, la superficie était de 2030,66 hectares dont 1938,88 hectares en terres cultivées et 91,78 hectares en terres non-cultivées (propriétés bâties, église, cimetière, chemins, places, étangs…). Les 1938,88 hectares comprenaient 246,413 hectares en prés, 37,628 hectares en jardins, 10,50 hectares en vergers et pâtis, 25,203 hectares en en landes et terres incultes, et 141,112 en bois et taillis.
A cette date, il y avait encore 103 fermes en exploitation. On y cultivait du froment (370 hectares), de l’orge (240 hectares), de l’avoine (190 hectares), du seigle (30 hectares) et du sarrasin (70 hectares). Les prairies naturelles représentaient 246 hectares et les prairies artificielles (luzernes, trèfles) 90 hectares. La culture de betteraves représentait 40 hectares et celle de pommes de terre, 90 hectares.
L’élevage se répartissait ainsi :
- Equidés : chevaux (races bretonnes, normandes ou percheronnes), hongres, juments, poulains et pouliches : 325 têtes. Les chevaux servaient principalement de bêtes de trait.
- Bovidés (croisement de la race mancelle et de la race Durham) : taureaux (40 têtes), bœufs (210), vaches 390), veaux (470). Les bœufs et vaches étaient « exclusivement élevés pour la boucherie et la reproduction ». Les bœufs étaient « recherchés par les marchands normands, vendéens et belges ».
- Ovidés (croisement de la race du pays avec races Disley et Southdown) : béliers (24), brebis (190), agneaux (250).
- Porcidés (race Craonnaise) : verrats (15), truies (190), porcs à l’engrais (95), porcelets (210).
- Volailles : oies (800), poules (poule noire et cochinchinoise) 1800, canes (420), pigeons (300). Les volailles étaient « une importante source de revenus et une provision continuelle de viandes ».
- Lapins. L’élevage de lapins s’élevait à 1200 animaux.
De nos jours, la commune a une superficie de 2050 hectares. Vergers, céréales, bovins, porcins, pâturages.
Aigrefoin. Ferme disparue. Ce nom vient du latin populaire acrus (du latin acer/acris, « âcre, acide ») et du latin fenum (foin). Désigne à l’origine une terre ingrate peu propice aux cultures.
En 1730, on signale en ce lieu les clos de vignes d’Egrefin. En 1794, Egrefoin était occupé par Marin Blanchet, journalier, âgé de 72 ans.
Cette ferme, disparue de nos jours, se situait au carrefour des routes de Loigné, de la Vernicière (autre ferme disparue), de la Roche et de la Frézelière. Voir carte ci-dessous extraite du plan cadastral de 1833.
En 1866, Aigrefoin était habitée par Joséphine Cahoreau, veuve Lanoë, 43 ans, journalière, Léontine Lanoë, sa fille, 13 ans, et Jacquine Lépine, femme Pichot, 44 ans, journalière.
Encore signalée en 1881, la ferme d’Aigrefin ou d’Aigrefoin fut détruite peu après 1900. Ses derniers occupants furent Pierre Civray, 47 ans en 1881, et son épouse Perrine Logeais, âgée de 50 ans. Les recensements de 1886, 1891 et 1901 ne signalent plus aucun habitant à Aigrefoin. Cela laisse supposer que la ferme inoccupée pendant une dizaine d’années ne résista pas aux assauts du temps.
Allaire (René). Curé de Loigné de 1695 à 1706. Il succéda à Charles de Quatrebarbes et précéda Pierre du Tremblier de la Varanne. Il fut inhumé le 30 avril 1706, à l’âge de 71 ans, dans le cimetière de Loigné en présence de Julien Pélard, curé de Fromentières, Julien Boucault et Pierre Parpacé, vicaire de Loigné.
Ameslant, Améland ou Amellant (Famille). Famille de noblesse originaire d’Angers qui, par acquisition, devint seigneur des Monceaux. Elle s’allia à la famille Couppel du Lude.
Ameslant (Louis-François). Bourgeois d’Angers, seigneur haut-justicier des fiefs et seigneuries de Rannay, la Hullainie, la Parfaiterie. Il acquit en 1738 la seigneurie des Monceaux (voir ce nom). Il épousa Cunégonde-Barbe du Moulin dont il eut Jeanne-Louise (née en 1741) et Cunégonde-Barbe qui suit. Il mourut en 1748 et sa femme en 1771.
Ameslant (Cunégonde-Barbe). Fille de Louis-François Ameslant, seigneur des Monceaux, et de Cunégonde-Barbe du Moulin. Le 7 mai 1765, elle épousa à Loigné Gervais Couppel du Lude (1724-1780), lui apportant ainsi la terre des Monceaux. Elle décéda à Château-Gontier le 15 pluviôse An V (3 février 1797). Elle eut pour enfants : Louis-Jean (né en 1766), Gervais (né en 1768), Siméon (né en 1770) et Agathe Couppel du Lude (née en 1777).
Artisans et commerçants. Voici ci-après la liste des artisans et commerçants de Loigné recensés sur quatre années (1866, 1901, 1935, 2015) :
Année 1866. Aubergistes : Françoise Cousin, épouse Chauvin ; Pierre Chartier ; Marie Barré, veuve Desnoë ; Jean Boulin, au hameau des Fosses. Boucher : Pierre Dubois. Bourrelier : Jean Delaunay. Buraliste : Paul Montpellier. Charrons : Pierre Lecomte qui employait un ouvrier et un apprenti ; Etienne Chrétien. Charpentiers : François Rezé ; Victor Rezé ; Louis Rezé ; Joseph Mainfray. Chiffonnier : César Nourry. Cordonniers : Théodore Guillet ; Pierre 4
Guillet. Couvreur : Auguste Petit. Couturière : Joséphine Chartier. Filassier : Théodore Chérubin. Maçons : François Fricot ; Julien Bouillon, au hameau de la Davière. Marchande : Adèle Jacquelin, épouse de Jean Viot. Maréchaux-ferrants : Jean Lion ; Julien Moreul. Menuisier : Jean Viot. Meuniers : Pierre Cousin au moulin des Vignes ; Jean Fouché au moulin de la Roche. Sabotier : Arsène Senciel. Tailleurs : Constant Geslin ; Jules Rousseau ; Pierre Rimbert, au hameau de Beauséjour. Tisserands : Alexis Ciron ; Pierre Ciron ; Auguste Mézière. Tonneliers : Louis Brillet ; Marin Cadot. Vétérinaires : Pierre Chartier ; Jean et Gabriel Orillard.
Année 1901. Boulanger : Baptiste Wégeais. Bucherons : Jean Lamy ; Henri Lalloyer ; Louis Moreau ; Eugène Gasnier ; Victor Guérin. Cabaretiers : Emilie Talluet, épouse Gernoult, Jean Philippe ; Elodie Blu, épouse Bulot ; Marie Fouchard, épouse Guillet ; Eugénie Peillon, épouse Lamy ; Marie Rousseau, épouse Dudoigt ; Aimée Besnier, épouse Livenet, à la Promenade ; Marie Ciron, épouse Robin, à Beauséjour ; Joséphine Losier, épouse Rezé, aux Fosses. Charpentier : Prosper Rezé. Charron : Pierre Conte qui employait 3 ouvriers. Cordonniers : Henri Guillet ; Jean Dudoigt. Couvreur : Eugène Moussu. Couturières : Joséphine Lalloyer, épouse Marteau ; Marie Hiret, épouse Régereau. Eclusier : Camille Fripier, à la Roche. Epicières : Marie Trois, épouse Wégeais ; Marie Godivier, épouse Renard ; Marie Ciron, épouse Fouchard ; Alphonsine Rousseau, épouse Lalloyer. Hongreurs : Jean Rimbaud ; Prosper Chartier. Laveuse : Scholastique Désert. Lingerie : Victorine Chartier. Lingères : Marie Bouvet, épouse Rimbert ; Anne Huchet, épouse Landais. Marchande-drapière : Vincennes Ciron. Maréchal-mécanicien : Emile Godivier. Maréchal : Alphonse Bulot. Menuisier : Joseph Huaumé. Minotier : Emmanuel Georges, à la Roche. Tailleur : Pierre Ledroit. Taupier : Florent Renard. Tonneliers : Auguste Bouillerie ; Prosper Métayer. Receveur-buraliste : Alexandre Gernoult.
Année 1935. Courtier ou marchand de bestiaux : Gouasbeau. Boulanger : Garreau. Charrons : Cocu ; Gaudret ; Marcille. Marchand de chaussures : Dudoigt. Débits de boissons et cafés : Bulot ; Forveille ; Veuve Gandon ; Lemanceau ; Lucas. Distillateur : Bulot. Epiceries-merceries : Garreau ; Huet ; Raimbault ; Renard. Forge-maréchalerie : Guet. Hongreurs : Huet ; Raimbault. Machines agricoles : Rousseau ; Guet. Maçon : Guyard. Meunier : Chaligné, à la Roche. Marchand de sable : Gournay. Tailleur : Ledroit.
Année 2015. Assureur : Yannick Quélin. Boulanger-pâtissier : Joël Journault. Bureau de tabac : Roland Rossignol, le Morilland. Cafés, bars, restaurants : Alain Bertron, le Café des Sports, Roland Rossignol, le Morilland. Carrelage-faïence-dallage : Florent Manceau. Cuisine-menuiserie : Guy Beaujean. Coiffure : Christelle Mourin. Garage automobiles : Auto-Méca, Nicolas Reillon. Menuiserie : Alain Houdayer. Location de bateaux : Yann Pérès à la Roche. Paysagistes : Jean-Marie et Pierre Maréchal ; Jardin de la Noë, Marc Mottier, à la Grande-Noë. Peinture-papiers peints : Gérard Bourjolay. Plomberie-chauffage-électricité : Patrick Durand. Métallerie-serrurerie : Fab’Métal, Fabien Chaudet. Conseiller en biomasse et méthanisation : Benoit Dutertre, à Vaufaron. Vente par automates : France-Terroir-Evénements, Eric Halopeau, 5, rue de Bretagne.
ASL. Association Sportive de Loigné-sur-Mayenne. Club de football créé le 1er octobre 1968 par un groupe de passionnés dont Daniel Thuault (ancien maire), Alexis Brielles, Paul Guet, Georges Brielles, René Gastineau, Roland Dutan, Léonce Gournay, Eugène Houssin, Alphonse Gardy, René Guiard, Gérard Baron et Mr et Mme Haume.
En mai 1969, on aménagea le terrain du bas. Le club comptait alors deux équipes de seniors. En 1972, on accueillit des jeunes et on mit en place une équipe « cadet ». En 1976, on créa une section « football à 7 ». En 1974, afin de pouvoir assurer les entraînements et les tournois nocturnes, on installa l’éclairage du terrain du bas. En 1981, on procédait à l’installation de douches dans les vestiaires et le club demandait à la commune la réalisation d’un deuxième
terrain de foot. En 1983, un premier match officiel eut lieu sur le terrain du haut. En janvier 2003, on inaugurait les nouveaux vestiaires et sa buvette.
Cette même année 2003, l’ASL atteignait les demi-finales de la Coupe du District.
Le 17 novembre 2004, le secrétaire Karl Notais et le webmaster Thomas Rossignol mettait en place le site internet de l’AS Loigné-sur-Mayenne.
Le 20 février 2005, les joueurs de l’ASL effectuaient une véritable prouesse en battant 1 à 0 l’Ancienne de Château-Gontier qui évoluait 5 divisions au dessus des Loignéens, en division d’honneur. Le but de la victoire, à la 80e minute, était du à Florent Manceau, ex-joueur de l’Ancienne.
Le 8 juin 2008, l’ASL accédait pour la première fois depuis sa création à la 1ère Division District.
Le 7 juillet 2008, le club fêtait joyeusement ses 40 ans. Le début des festivités commença par une remise de récompenses décernées par la LMF en présence de Jean-Michel Godart, ancien gardien de but professionnel du Stade lavallois. Médailles de vermeil : Christian Notais, dirigeant depuis 1978 et trésorier-adjoint ; Jean-Paul Forveille, 29 ans passés au club en tant que secrétaire, coach, arbitre et responsable des 13-15-18 ans, dirigeant jusqu’en juin 2008 ; Patrick Durand, joueur de l’équipe senior A et B depuis 1975, dirigeant depuis 1979. Médailles d’argent : Pierre Hermenier, dirigeant depuis 1988 et président depuis 2005 ; Michel Chevalier, arbitre du club depuis 1991 ; Michel Denuault, au club depuis 1968 comme joueur puis dirigeant (1985) ; Karl Notais, dirigeant depuis 1995 et secrétaire depuis 1996 ; Marie-Claire Gastineau, trésorière puis dirigeante depuis 1992 ; Gabriel Denuault et Maurice Bouvet, supporters de l’ASL depuis 1968. Après un repas préparé par les restaurateurs de Loigné (MM Bertron et Rossignol), de petits matchs (anciens joueurs et joueurs actuels), la journée d’anniversaire se clôtura par un buffet dansant sous chapiteau.
Le 3 octobre 2010, l’équipe 1 atteignait le 4e tour de la Coupe de France et jouait pour la première fois avec le maillot du sponsor officiel de la Coupe de France. Le match contre l’US Guecelard se soldat par une défaite (1-0).
De nos jours, en 2015, l’ASL compte 34 dirigeants bénévoles et 145 licenciés évoluant en U7, U9, U11, U13, U15, U17, U19, séniors et vétérans.
Les trois équipes séniors évoluent en championnat départemental : l’équipe A en 1ère Division, l’équipe B en 3e Division et l’équipe C en 5e Division.